|
| |
|
|
 |
|
DROITS DE L'HOMME |
|
|
| |
|
| |
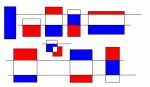
droits de l'homme
LE CONCEPT DE « DROITS NATURELS »
Les droits de l'homme, et les libertés dont ils s'accompagnent, sont ceux dont tout individu doit jouir du fait même de sa nature humaine. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui marque l'avènement théorique d'un État de droit dotant l'individu du pouvoir de résistance à l'arbitraire et lui reconnaissant des droits naturels, dits fondamentaux. La notion de « déclaration des droits » découle de deux idées : celle de l'existence de droits individuels et celle de la nécessaire affirmation de ces droits par une autorité légitime, en l'occurrence le pouvoir constituant en 1789, c'est-à-dire l'État. Matrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948, le texte de 1789 est l'aboutissement d'une réflexion qui a commencé avec la Grande Charte d'Angleterre de 1215 et qui passe par l'institution de l'habeas corpus en 1679.
→ charte.
Il appartient à l'État de droit de respecter les libertés fondamentales de l'individu, que le concept de « libertés publiques » traduit en termes constitutionnels. La persistance de nombreux cas de violations des droits de l'homme dans l'histoire contemporaine impose de garantir leur protection à l'échelon international. Non seulement celle-ci suppose l'existence de mécanismes juridiques autorisant des organes internationaux à exercer un contrôle sur l'application des normes relatives aux droits de l'homme, mais encore l'action d'organisations indépendantes des États, qui se révèlent aussi de la première importance.
TROIS SIÈCLES D'HISTOIRE DES DROITS DE L'HOMME
Ce sont les philosophes du xviiie s., parmi lesquels Jean-Jacques Rousseau, qui élaborent le concept de « droits naturels », droits propres aux êtres humains et inaliénables, quels que soient leur pays, leur race, leur religion ou leur moralité. La révolution américaine de 1776, puis la révolution française de 1789 marquent la reconnaissance et la formulation explicite de ces droits.
Dès 1689, en Angleterre, a été proclamé le Bill of Rights. Les colons établis en Amérique en retournent les principes contre leur roi. La Déclaration d'indépendance américaine, le 4 juillet 1776, affirme la primauté des droits et libertés. Au cours de la décennie suivante, par l'entremise du marquis de La Fayette et de Thomas Jefferson, elle éclaire les révolutionnaires français, notamment sur la notion de souveraineté du peuple.
Les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont discutés et votés entre le 20 et le 26 août 1789, alors que l'Assemblée constituante est en conflit avec le roi. Destinée à préparer la rédaction de la première Constitution écrite française, en la fondant sur l'énonciation des principes philosophiques qui doivent former la base de la société, elle proclame les droits « naturels et imprescriptibles » de l'homme, c'est-à-dire ceux que chacun doit exercer par le fait qu'il est homme et sans distinction de naissance, de nation ou de couleur. Après une définition générale de la notion de liberté, la Déclaration précise un certain nombre de libertés particulières : liberté de conscience et d'opinion, liberté de pensée et d'expression, droit à la propriété. L'égalité est la deuxième grande notion de la Déclaration : égalité des droits, égalité devant la loi et la justice, égalité devant l'impôt, égale admissibilité aux emplois publics. L'État nouveau, édifié sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur la notion de souveraineté du peuple, devient le garant des droits.
Au xixe s., la Déclaration de 1789 inspire le mouvement politique et social en Europe et en Amérique latine. Avec l'industrialisation grandissante, l'essor du pouvoir capitaliste et financier, la revendication des droits s'enrichit en effet de la notion de droits sociaux, et particulièrement de droit au travail, sous l'influence du socialisme à la française, puis du socialisme marxiste. Mais les génocides, l'esclavage, qui ne sera aboli que lentement et inégalement, le colonialisme, le travail des enfants, la sujétion des femmes, dont l'émancipation – quand elle aura lieu – sera tardive, sont autant d'obstacles historiques sur la voie d'une reconnaissance pleine et entière des droits de l'homme. La France et les États-Unis eux-mêmes rechigneront souvent à montrer l'exemple, malgré la création d'associations philanthropiques et la lutte pour la prise en compte des droits sociaux (droit de grève, amélioration des conditions de travail, réduction du temps de travail).
Selon l'article 55 de la Charte des Nations unies de 1945, l'O.N.U. doit favoriser le respect universel et effectif des droits de l'homme avec le concours des États membres. Mais la politique des blocs, l'un sous influence américaine, l'autre sous influence soviétique, perturbe pendant plusieurs décennies les débats. Tandis que les Américains insistent sur la notion de droits politiques, les démocraties libérales d'Europe défendent celle de droits sociaux. Compte tenu des deux options, les Nations unies tentent de réaliser leur mission à travers l'action de la Commission des droits de l'homme, créée en 1946. Ceux-ci deviennent une valeur internationalisée en 1948. Il est reconnu que l'homme détient un ensemble de droits opposables aux autres individus, aux groupes sociaux et aux États souverains. Les droits de l’homme sont par la suite étendus à l’enfant : le 20 novembre 1989, les Nations unies adoptent la Convention des droits de l'enfant, afin de protéger l'enfance de la famine, de la maladie, du travail, de la prostitution et de la guerre.
→ droits de l'enfant.
LES DROITS DE L'HOMME FACE AU PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ
Le principe des droits humains, tout comme la notion de paix, fait partie de ces thèmes a priori consensuels et irréfutables sous peine de placer le réfractaire en marge de la communauté internationale. L'humanité entière est révulsée par la barbarie, et un régime criminel ne peut, moralement, asseoir sa légitimité sur la seule souveraineté de l'État.
Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) ont manifesté la valeur de ce raisonnement. Dès 1950, l'Assemblée générale des Nations unies a créé un comité chargé de rédiger le projet de statut d'une juridiction pénale internationale permanente. Mais la guerre froide a eu raison de ces vœux pieux. Le fait que ce projet n'ait pris forme qu'en 1998 témoigne – de même que ses limites – de la résistance opiniâtre des États : aucun d'eux ne cherche spontanément à promouvoir une justice supranationale à laquelle il serait soumis et devant laquelle des citoyens, nationaux ou étrangers, pourraient le traduire. C'est la même attitude qui a freiné les progrès de l'arbitrage international depuis les conférences de la Paix de 1899 et 1907, et limité, malgré deux guerres mondiales, les prérogatives de la Société des Nations puis de l'O.N.U. En réalité, l'opinion publique, alertée par les médias et les organisations non gouvernementales, est un acteur extrêmement important de ces évolutions. C'est à elle qu'il revient de dénoncer les abus de pouvoir, en l'occurrence les crimes commis par les dictateurs, l'altération du principe d'égalité, la négation des droits sociaux, ou encore la corruption des élites dirigeantes. Mais la seule sanction morale ne suffit pas à faire reculer les États coupables. La Déclaration universelle des droits de l'homme exige, par conséquent, pour ne pas être qu'un leurre, que la communauté internationale soit dotée de juridictions qui permettent de se saisir des cas de violation de ces droits.
Voir les articles justice internationale : TPIR, TPIY.
LES INSTITUTIONS AU SERVICE DES DROITS DE L'HOMME
LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'O.N.U.
Créée en 1946, la Commission se réunit pour la première fois en 1947 pour élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rédigée en un an, celle-ci est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Depuis lors, la date du 10 décembre est célébrée tous les ans en qualité de « Journée des droits de l'homme ».
Jusqu'en 1966, les efforts de la Commission sont essentiellement de nature normative, attendu que, dans une déclaration de 1947, elle estime « n'être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de réclamations relatives aux droits de l'homme ». Ses travaux aboutissent, en 1966, à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; ces deux pactes forment, avec la Déclaration universelle, la Charte internationale des droits de l'homme.
En 1967, le Conseil économique et social autorise la Commission à traiter des violations des droits de l'homme. Aussi met-elle au point des mécanismes et procédures afin de vérifier le respect par les États du droit international relatif aux droits de l'homme et de constater les violations présumées de ces droits par l'envoi de missions d'enquête. En outre, la Commission met de plus en plus l'accent sur la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit au développement et le droit à un niveau de vie convenable. Elle s'intéresse de près, comme le démontre la Déclaration de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993, à la protection des droits des groupes sociaux vulnérables, des minorités et des peuples autochtones, ainsi qu'à la promotion des droits de l'enfant et des femmes. La démocratie et le développement sont considérés comme deux facteurs nécessaires à l'épanouissement des droits de l'homme.
Décrédibilisée par la présence en son sein de pays critiqués pour leurs propres atteintes aux droits de l’homme, elle est dissoute en 2006, et remplacée par le Conseil des droits de l’homme. Cet organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies est notamment chargé d’effectuer un examen périodique de tous les pays au regard des droits de l'homme, et de formuler aux États concernés des recommandations.
LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
Établie par le Conseil de l'Europe en 1950 et entrée en vigueur en 1953, la Convention européenne se situe dans la continuité de la Déclaration universelle de 1948. Chaque État qui adhère au Conseil de l'Europe est tenu de la signer et de la ratifier dans un délai d'un an. Les États signataires s'engagent alors à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction certains droits civils et politiques et certaines libertés définis dans la Convention. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, un individu qui s'estime lésé dans ses droits peut entamer des procédures à l'encontre de l'État contractant qu'il tient pour responsable. Un État contractant peut également intenter une procédure contre un autre État contractant : c'est ce que l'on appelle une requête interétatique.
Le fait que des États souverains acceptent qu'une juridiction supranationale remette en cause les décisions de juridictions internes et qu'ils s'engagent à exécuter ses jugements a représenté une étape historique dans le développement du droit international. La théorie selon laquelle les droits de l'homme ont un caractère fondamental les plaçant au-dessus des législations et des pratiques nationales a été appliquée. Cela revient à reconnaître qu'il ne faut pas laisser un État décider lui-même de l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fonction de considérations politiques nationales.
La Convention a instauré une Cour européenne des droits de l'homme, chargée d'examiner les requêtes individuelles et interétatiques. Les juges de la Cour, totalement indépendants, sont élus par le Parlement européen. Le Conseil des ministres surveille l'exécution des arrêts de la Cour. Le droit de recours individuel est automatique, ainsi que la saisine de la Cour dans le cadre des requêtes individuelles et interétatiques.
LES GRANDES ÉTAPES INSTITUTIONNELLES DE LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
1215 : la Grande Charte d'Angleterre (Magna Carta) énumère, après les excès de Jean sans Terre, un certain nombre de dispositions tendant à protéger l'individu contre l'arbitraire royal en matière de taxes ou de spoliation de biens, et assure à chaque sujet un procès équitable dans le cadre de l'égalité de traitement devant la loi.
1679 : l'habeas corpus, en Angleterre, garantit le respect de la personne humaine et la protège d'arrestations et de sanctions arbitraires. Le roi est ainsi privé du pouvoir de faire emprisonner qui il veut selon son bon plaisir.
1689 : la Déclaration des droits (Bill of Rights), adoptée par la Chambre des lords et la Chambre des communes, réduit le pouvoir royal en Angleterre, en proclamant notamment la liberté de parole au sein du Parlement et le droit pour les sujets d'adresser des pétitions au monarque.
4 juillet 1776 : la Déclaration d'indépendance américaine, rédigée par Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et John Adams, et inspirée de la philosophie des Lumières, est signée à Philadelphie par les délégués des treize colonies et promulgue un contrat social fondé sur l'indépendance, l'égalité, la liberté et la recherche du bonheur (« We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness »).
26 août 1789 : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, destinée à devenir l'archétype des déclarations ultérieures, est adoptée par l'Assemblée constituante.
3 septembre 1791 : la première Constitution écrite française garantit pour chacun « des droits naturels et civils ».
26 juin 1945 : la Charte des Nations unies, signée à San Francisco, internationalise le concept de droits de l'homme.
10 décembre 1948 : la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'O.N.U. est la première référence aux libertés fondamentales communes à tous les peuples de la Terre. Aux obligations morales liées à l'universalité du message s'ajoutent, pour les pays signataires, de réelles obligations juridiques qui sont censées instituer autant de garanties pour les peuples concernés.
4 novembre 1950 : la Convention européenne des droits de l'homme est signée à Rome sous l'égide du Conseil de l'Europe ; elle entre en vigueur en 1953.
1er août 1975 : l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.), signé à Helsinki, fait figurer le « respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » parmi les principes de base qui régissent les relations mutuelles des 35 États participants.
LES ORGANISMES DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
La Ligue est le plus ancien organisme de défense des droits et des libertés. Elle est fondée, en février 1898, par l'ancien ministre de la Justice Ludovic Trarieux et quelques amis, à l'occasion du procès intenté à Émile Zola qui venait de faire paraître dans le journal l'Aurore son célèbre réquisitoire « J'accuse ». Après l'affaire Dreyfus, la Ligue poursuit son engagement en prenant position sur les grands débats contemporains. Ainsi, en 1905, elle se déclare en faveur de la séparation des Églises et de l'État ; en 1909, son président réclame le droit de vote pour les femmes et leur éligibilité à la Chambre et au Sénat. La Ligue suit de près l'évolution de la vie politique et, en 1935, c'est à son siège qu'est signé le programme du Front populaire par les socialistes, les radicaux et les communistes.
En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, reprend largement le projet du représentant français René Cassin, membre de la Ligue des droits de l'homme. Par la suite, celle-ci joue un rôle dans les protestations contre l'utilisation de la torture lors de la guerre d'Algérie, dans les revendications étudiantes de mai 1968, dans les actions qui amènent, en 1973, la modification de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ou encore en faveur de l.’abolition de la peine de mort. Plus récemment, elle s’est engagée dans les années 1990 contre la montée du racisme, et pour l’extension des droits des étrangers, ainsi que pour la régularisation des sans-papiers.
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME (F.I.D.H.)
Fondée en 1922, la Fédération est la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme au plan international. Elle a son siège en France. Organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique, elle se déclare également apolitique, non confessionnelle et non lucrative. Elle se voue à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme en informant l'opinion publique et les organisations internationales par le biais de lettres, de communiqués et de conférences de presse. Comme Amnesty International, la F.I.D.H. bénéficie du statut d'observateur auprès des instances internationales (Nations unies, Unesco, Conseil de l'Europe, Commission africaine des droits de l'homme).
AMNESTY INTERNATIONAL
C'est en 1961, à l'initiative de Peter Benenson (1921-2005), avocat britannique, qu'un groupe d'avocats, de journalistes, d'écrivains, choqués par la condamnation de deux étudiants portugais à vingt ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté dans un bar, lance un appel pour l'amnistie (Appeal for Amnesty). L'acte de naissance officiel du mouvement Amnesty International peut être daté du 28 mai 1961, lorsque le supplément dominical du London Observer relate l'histoire de six personnes incarcérées pour « raisons de conscience » – parce qu'elles ont exprimé leurs croyances religieuses ou politiques – et exhorte les gouvernements à relâcher de tels prisonniers. Amnesty International, organisation indépendante à caractère non gouvernemental, mène depuis lors une action vigoureuse de défense des droits de l'homme, à l'adresse des gouvernements qu'elle fustige dans son rapport annuel et de l'opinion publique internationale. Au cours des années 1970, Amnesty International s'est vu confier le statut d'observateur pour le compte des Nations unies. En 1977, son action a été récompensée par le prix Nobel de la paix, titre qui n'impressionne pas forcément tous les gouvernements.
PLAN
*
* LE CONCEPT DE « DROITS NATURELS »
* TROIS SIÈCLES D'HISTOIRE DES DROITS DE L'HOMME
* LES DROITS DE L'HOMME FACE AU PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ
* LES INSTITUTIONS AU SERVICE DES DROITS DE L'HOMME
* La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U.
* La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
* LES ORGANISMES DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
* La Ligue des droits de l'homme
* La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (F.I.D.H.)
* Amnesty International
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LE GOTHIQUE |
|
|
| |
|
| |
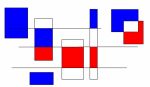
gothique
(bas latin gothicus)
Consulter aussi dans le dictionnaire : gothique
Cet article fait partie du dossier consacré au style.
Se dit d'une forme d'art qui s'est épanouie en Europe du xiie s. jusqu'à la Renaissance.
BEAUX-ARTS
1. INTRODUCTION
Le mot gothique apparaît au xvie s. pour qualifier l'architecture médiévale du nord des Alpes par opposition aux formes classiques reprises de l'Antiquité par la Renaissance italienne. De nos jours encore, le gothique se définit mieux dans l'architecture que dans les autres domaines de l'art.
Caractérisé par l'emploi de l'arc brisé, joint à la voûte sur croisée d'ogives et à l'arc-boutant, il s'étend du milieu du xiie s. au début du xvie s.
Il est plus malaisé de le définir dans la peinture, qui ne devient réellement gothique qu'au xiiie s. et qui, dès 1400, au moins en Italie, s'en éloigne. En fait, l'art gothique, qui s'est développé dans toute l'Europe occidentale, n'est pas apparu partout au même moment. Il a évolué différemment selon les contrées.
2. LE PREMIER ART GOTHIQUE
Apparu tout d'abord dans l'architecture, l’art gothique est lié à l'abbé Suger et voit son éclosion à l'église de Saint-Denis, près de Paris. C'est là que, pour la première fois, vers 1140, il s'affirme avec maîtrise.
2.1. L’ABBATIALE DE SAINT-DENIS
Les parties basses du chœur de Saint-Denis mettent en œuvre voûtes sur croisée d'ogives, supports minces et arcs brisés, plus résistants que les arcs en plein cintre. L'abbé Suger privilégie ces moyens novateurs car pour lui l'église doit être sur terre le reflet de l'église céleste, demeure du Seigneur. Et cette évocation céleste ne peut être rendue que par la lumière, qui pénètre abondamment dans les structures minces par l'intermédiaire des vitraux, mode d'expression majeur de la peinture à l'époque gothique. La préférence accordée aux nouvelles techniques satisfait également un désir de clarification, comme l'a montré Erwin Panofsky. On est alors à l'âge de la scolastique et l’on aime argumenter, définir, classer. Les procédés gothiques de construction permettent de fait de donner une grande lisibilité aux structures, de souligner, par le graphisme des colonnes, des chapiteaux et des moulures, les lignes de force des supports et leurs prolongements sous les voûtes dans le jeu des ogives et des doubleaux, la division des travées et la séparation stricte des étages. Cette même clarté reparaît dans la répartition des sculptures aux portails : statues-colonnes, voussures, trumeau, linteau, tympan.
C'est à Saint-Denis que se manifeste avec évidence cet esprit nouveau. Pourtant, la voûte sur croisée d'ogives était employée depuis la fin du xie s. en Angleterre et en Normandie, et l'arc brisé était d'un usage courant dans la Bourgogne romane. La création de l'art gothique tient à ce que, par le moyen de techniques éprouvées et associées, Saint-Denis exprime un style nouveau de légèreté, de lumière et de clarté logique, qui rompt avec la robustesse, le schématisme et parfois la confusion de l'art roman.
2.2. LE PORTAIL ROYAL DE CHARTRES
Contemporain de Saint-Denis, le portail royal de Chartres, mieux conservé que la façade de l'abbatiale de Suger, montre dans une majesté grandiose et dans une composition rigoureuse la plénitude de la vision gothique dans la sculpture. C'est une vaste synthèse iconographique, le « miroir du monde », selon l'expression d'Émile Mâle, reprise des auteurs du xiiie s., où toutes les images de l'univers céleste et terrestre s'ordonnent hiérarchiquement autour du Christ triomphant, dans un accord parfait avec la structure architecturale des portes.
2.3. DIFFUSION ET ÉVOLUTION DES MODÈLES
La sculpture de Chartres est rapidement imitée en Île-de-France et sur la Loire tandis que le chevet de Suger, à doubles bas-côtés et chapelles rayonnantes juxtaposées, connaît une longue descendance (cathédrale de Noyon, abbatiale de Saint-Germain-des-Prés).
SENS
La cathédrale de Sens est le premier grand édifice entièrement gothique construit dans le milieu du siècle. Elle utilise les voûtes d'ogives sexpartites, mises au point en Normandie dès les années 1120, et emploie l'alternance des supports, colonnes jumelles et piles composées. Son élévation est à trois étages, comme, plus tard, les cathédrales du xiiie s. Dépourvue de transept à l'origine, sa relative simplicité contraste avec la complexité des édifices de la seconde moitié du siècle.
NOYON ET LAON
En effet, des cathédrales comme celles de Noyon et de Laon multiplient alors les étages d'ouvertures, arcades, tribunes, triforium, fenêtres hautes, et adoptent des transepts étendus. Dans cette région du nord-est de la France se développe un grand foyer d'architecture dans la seconde moitié du xiie s. À Laon est utilisé pour la première fois de façon systématique le triforium-galerie de passage, qui allait être un des traits distinctifs des grandes cathédrales.
REIMS
Saint-Remi de Reims illustre particulièrement la recherche de lumière, multipliant les fenêtres à la façade et au chevet, creusant les murs de passages et faisant jouer les colonnes pour accentuer la plasticité des formes. Le mur, qui fait alterner pénombre et luminosité, devient diaphane, selon l'expression de Hans Jantzen. Ce mur « modelé » reparaît aux transepts de Noyon et de Soissons, et essaime vers l'Angleterre et vers la Bourgogne jusqu'à Lausanne.
PARIS
Notre-Dame de Paris appartient aussi dans son ensemble à cette époque. Primitivement dotée de quatre étages, couverte de voûtes sexpartites, elle a abandonné l'alternance au profit d'une continuité plus sobre des travées. Dans cette église, on projette de construire la nef en l'étayant d'arcs-boutants. Ce système de contre-butement, typiquement gothique, a d’abord été expérimenté à Mantes, à Saint-Remi de Reims, peut-être à Saint-Germain-des-Prés, mais c'est à partir des années 1180 qu'on comprend tout le parti qu'on peut en tirer pour supprimer les tribunes et accroître encore la lumière intérieure par l'agrandissement des fenêtres hautes.
ANGERS
L'art gothique s’y montre également précoce. Dès le milieu du xiie s., la cathédrale adopte la croisée d'ogives sur plan carré, sous des voûtes bombées comme des coupoles.
POITIERS
À Poitiers, on entreprend une cathédrale à trois vaisseaux à peu près de même hauteur, avec un chevet plat, des supports légers, sans étages ni arcs-boutants, et avec des voûtes bombées recoupées de nervures perpendiculaires, ou liernes.
BOURGOGNE ET CHAMPAGNE
Les Cisterciens, en Bourgogne et en Champagne, utilisent de bonne heure l'arc brisé et la voûte sur croisée d'ogives. L'abbatiale de Pontigny, dans l'Yonne, en demeure un des meilleurs exemples.
3. LE STYLE 1200
Autour de 1200 apparaît dans les arts figurés un style souple et fluide, éloigné de la rigueur gothique, qui plonge ses racines dans un lointain passé teinté de nostalgie pour l'art antique et paléochrétien. Son grand maître est un orfèvre lié au milieu mosan, Nicolas de Verdun, qui tire du métal des figures puissamment modelées sous leur drapé « mouillé », à la châsse de Notre-Dame de Tournai comme à l'ambon de Klosterneuburg (près de Vienne).
La seconde Bible de Winchester annonce ce courant particulier dans la peinture, qui se manifeste dans le psautier d'Ingeburge (Chantilly) et dans les vitraux de Laon.
La sculpture sur pierre du nord-est de la France en porte la marque à Saint-Remi de Reims, à la cathédrale de Laon, et les statues de la Visitation de la cathédrale de Reims en constituent une image tardive et sans suite, en raison du triomphe de l'art proprement gothique.
4. L'ÂGE DES GRANDES CATHÉDRALES
4.1. LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
Toutes les expériences architecturales du xiie s. aboutissent à l'éclosion d'un chef-d'œuvre, la cathédrale de Chartres, qui fut reconstruite, à l'exception de la façade, après l'incendie de 1194. Elle confirme les recherches antérieures : les murs sont articulés très lisiblement, sans alternance. Les voûtes sont quadripartites. Les piles, composées, se plantent de biais pour répondre aux diagonales des ogives et engendrent ainsi un dynamisme ignoré des premières œuvres gothiques. Le triforium-passage, dernière zone d'ombre, se situe entre des arcades et des fenêtres composées d'importance égale, dans un équilibre parfait. Chartres abandonne la tribune, la voûte sexpartite, les effets de passage dans les murs pour la sobriété des travées simples à trois étages. C'est une œuvre classique dans la mesure où classicisme signifie équilibre, mesure et simplicité. Les arcs-boutants règnent en maîtres à l'extérieur, hérissé de tours, décoré de porches, dont la richesse un peu lourde s'oppose à l'harmonie paisible de l'ordonnance interne.
Contemporaine de Chartres, au moins pour le chevet, la cathédrale de Soissons révèle les mêmes qualités. Un peu plus jeune, la cathédrale de Reims est l'héritière directe de Chartres, avec plus de raffinement et d'élancement, et une façade sculptée incomparable.
4.2. LA CATHÉDRALE DE BOURGES
La cathédrale de Bourges, contemporaine de Chartres, montre la richesse d'invention du xiiie s. Son vaisseau central, sans transept, est assis sur des piles très élevées. À travers les arcades, on voit l'étagement des doubles collatéraux, de hauteur différente. Il en résulte un espace intérieur prodigieux. Le Maître de Bourges ne renonce ni aux voûtes sexpartites, ni au jeu des colonnes, qui articulent fortement les murs dans une alternance savante, et cette plasticité se maintient en Bourgogne, à Auxerre, à Notre-Dame de Dijon.
4.3. LE GOTHIQUE EN NORMANDIE
La Normandie se convertit à l'art gothique à la fin du xiie s., à Fécamp, à Lisieux, et, à partir du chevet de Saint-Etienne de Caen, crée un art original, aux arcs très aigus et très moulurés, aux murs percés de nombreux passages. Cette architecture s'épanouit avec les cathédrales de Rouen, de Coutances, de Bayeux et, plus tard, de Sées. Il faut y rattacher la Merveille du Mont-Saint-Michel, bâtie de 1203 à 1228, et aussi le chevet de la cathédrale du Mans.
4.4. DIFFUSION DE L’ART GOTHIQUE
L'ordre cistercien, en pleine expansion, exporte l'architecture gothique vers l'Italie, à Chiaravalle Milanese ou à Fossanova, vers l'Allemagne, à Eberbach ou à Maulbronn, vers l'Espagne, à Poblet ou à Veruela, vers le Portugal, à Alcobaça, vers l'Angleterre, à Fountains Abbey ou à Rievaulx.
Mais, indépendamment des fondations cisterciennes, l'Angleterre élabore rapidement une nouvelle architecture. L'art gothique apparaît au chœur de la cathédrale de Canterbury, construit en 1175 sous la direction de Guillaume de Sens. Le chœur de Chichester, la cathédrale de Lincoln, à l'aube du xiiie s., montrent des caractères proches de l'art normand, mais y ajoutent la polychromie des marbres noirs de Purbeck sur fond de calcaire blanc, accentuent la profondeur des murs et adoptent des plans très allongés, le plus souvent à chevet plat. La tour-lanterne, comme en Normandie, domine au-dessus des longues toitures, où les arcs-boutants se dissimulent volontiers, à l'inverse des contre-butements français. La cathédrale de Salisbury, commencée en 1220, consacre ce nouveau style.
4.5. ÉPANOUISSEMENT DE LA SCULPTURE
Pendant que s'élèvent les cathédrales, la sculpture sur pierre envahit les façades. Le portail de la cathédrale de Senlis, à la fin du xiie s., avec son Triomphe de la Vierge, repris à Chartres et à Paris, marque un tournant et révèle un style plus humanisé que celui du portail royal de Chartres, tout en restant monumental. Cette sculpture calme, noble et sereine s'affirme aux six portes du transept de Chartres, dans les tympans comme dans les statues des apôtres, des martyrs et des confesseurs des ébrasements ou dans le Beau Dieu du trumeau de la porte du Jugement dernier. Le saint Firmin et le Beau Dieu d'Amiens, le Jugement dernier de Notre-Dame de Paris, le Beau Dieu de la cathédrale de Reims illustrent aussi cet art de haute qualité.
5. LE GOTHIQUE RAYONNANT
Vers 1230-1240, le domaine capétien, déjà si riche en expériences, donne naissance au style rayonnant, qui conquiert, grâce au prestige de la royauté française, l'Europe occidentale et se continue jusque dans le courant du xive s.
5.1. ARCHITECTURE
Ce style demeure gothique dans sa structure et ses procédés, mais il rompt avec l'équilibre instauré à Chartres, par une recherche de plus grande unité spatiale, obtenue par des ouvertures plus vastes au rez-de-chaussée, afin de faire communiquer vaisseau central et bas-côtés, et par des volumes plus ramassés et plus concentrés, qui réduisent le transept ou le déploiement du chevet. La lumière efface les dernières zones d'ombre grâce au vitrage des triforiums ou à leur suppression. L'articulation des murs tend à disparaître dans l'amenuisement des supports, qui se fondent dans un riche décor continu au triforium et plus encore aux fenêtres hautes, décomposées par leurs remplages en séries de lancettes surmontées de trilobes, de quatre-feuilles et de roses. Le réseau des fenêtres se poursuit à l'extérieur et couvre de ses motifs contreforts et arcs-boutants.
FRANCE
Le gothique rayonnant se manifeste à Notre-Dame de Paris dans les chapelles latérales et aux deux roses du transept, à meneaux « rayonnants », œuvres de Jean de Chelles et de Pierre de Montreuil. Il apparaît aussi au transept et à la nef de Saint-Denis ainsi qu'à la cathédrale d'Amiens, commencée en 1220 par Robert de Luzarches. Dans cet édifice, la nef rompt avec les proportions chartraines ; l'évolution est plus nette au chevet bâti par Thomas et Renaud de Cormont : le triforium s'y ajoure, se couronne de gables, se mêle au réseau des fenêtres.
La Sainte-Chapelle de Paris (1241-1248) est sans doute l'exemple le plus connu de cet art. C'est à la fois un édifice et un reliquaire. L'étage supérieur n'est plus qu'un espace unique, ouvert de toutes parts à la lumière ; il faut un effort pour retrouver dans la succession des fenêtres la structure architecturale.
Les cathédrales de Troyes, de Tours, la nef de la cathédrale de Strasbourg (tout comme, en Europe, la cathédrale de Cologne et l'abbatiale de Westminster) diffusent le style rayonnant, qui supplante les inventions régionales : en Champagne, à Saint-Urbain de Troyes ; en Bourgogne, à Saint-Bénigne de Dijon ; en Normandie, à Évreux et à Saint-Ouen de Rouen. Il s'étend dans le Sud : à Saint-Nazaire de Carcassonne, dans les églises bâties par Jean Deschamps (1218 ?-1295) [Clermont, Limoges] et plus tard à La Chaise-Dieu.
EUROPE
L'Angleterre, malgré l’exemple de Westminster, reste fidèle à ses traditions et adapte les éléments rayonnants, surtout connus dans les milieux de la cour de Londres, à ses créations propres. C'est l'époque du style décoré – decorated style – , qui se poursuit jusqu'au milieu du xive s. à travers les cathédrales d'Exeter, de Winchester, d'York, la nef de Canterbury et l'extraordinaire tour-lanterne octogonale en bois d'Ély.
L'Allemagne, longtemps réticente à l'architecture gothique, l'accepte au xiiie s. à Mayence, à Trèves (Notre-Dame), à Marburg (Elisabethkirche). Après 1250, les cathédrales de Strasbourg et de Cologne imposent le style rayonnant, puis, très vite, s'élaborent des formules originales, comme la tour unique de la façade de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau.
L'art gothique s'étend aussi vers le nord : à l'église des saints Michel et Gudule de Bruxelles et jusqu'au Danemark et en Suède.
Vers le sud, il s'implante en Espagne, à Ávila, à Burgos, à Tolède, à León, mais il s'y mêle un décor très particulier : l'art mudéjar, qui emprunte à l'islām, florissant dans le Sud, ses motifs et ses procédés.
L'architecture gothique se rencontre aussi en Italie, adoptée par les ordres mendiants à San Francesco d'Assise et à Bologne, plus tard à Santa Croce de Florence. La cathédrale de Sienne appartient au gothique du xiiie s. dans sa majeure partie, mais avec une polychromie de marbres dans la tradition locale. À la cathédrale d'Orvieto, un peu après, les architectes dressent une façade garnie de gables gothiques, mais ne voûtent pas l'intérieur, manifestant ainsi un refus des procédés gothiques et un retour à l'art paléochrétien.
5.2. SCULPTURE
En même temps que l'architecture, la sculpture évolue. Dans la flore des chapiteaux apparaissent des feuillages et des fleurs directement inspirés de la nature (Notre-Dame de Paris, Sainte-Chapelle, cathédrale de Reims). Les statues s'animent, s'isolent et se font expressives : apôtres à l'intérieur de la Sainte-Chapelle, saint Joseph et l'ange au sourire de Reims.
Ces sculptures eurent un grand succès et une suite : par exemple avec la Vierge dorée du transept d'Amiens, aux portails de Bourges, à Strasbourg dans les statues de l'Église et de la Synagogue, des Vierges sages et des Vierges folles, à Mayence et, au-delà du Rhin, avec le Cavalier de Bamberg et, à un degré moindre, à Naumburg dans les célèbres statues des fondateurs. La beauté de ces sculptures s'exprima avec une rare délicatesse dans les ivoires parisiens.
L'influence de la sculpture française se sentit jusqu'en Italie, chez Giovanni Pisano, fils de Nicola, qui allia la plastique gothique aux traditions des reliefs antiques, avec une agitation dramatique, à la cathédrale de Sienne et à Pise.
5.3. PEINTURE
La peinture française fut dominée par l'art du vitrail à Chartres, à Bourges ou à la Sainte-Chapelle. Son ascendant fut tel que les miniatures, comme celles du Psautier de Saint-Louis (Bibliothèque nationale), adoptèrent pour cadres les réseaux des verrières. Les châsses, telles celle de saint Taurin à Evreux et celle de sainte Gertrude à Nivelles, prirent la forme d'une église couverte de fenestrages. Même les portails, comme celui de Saint-Etienne à Sens, se décorèrent de réseaux rayonnants.
En Italie, Giotto, à l'aube du xive s., renouvela la peinture italienne, la dégagea des traditions byzantines, lui insuffla une monumentalité et une puissance plastique qui montrent des contacts avec la sculpture des cathédrales françaises, mais aussi un retour aux valeurs antiques, à l'Arena de Padoue comme à Santa Croce de Florence. Aucun peintre, au nord des Alpes, vers 1300, ne peut être comparé à Giotto, mais on trouve des ateliers d'enlumineurs, notamment à Paris, autour du maître Honoré.
6. LE XIVe S. JUSQUE VERS 1380
On admet généralement que le style rayonnant se poursuit au cours de la majeure partie du xive s. En fait, c'est une époque encore mal étudiée, qui révèle le développement de particularismes locaux, voire nationaux, jusqu'à l'éclosion du style international à la fin du siècle.
6.1. ARCHITECTURE
ARCHITECTURE RELIGIEUSE
Les constructions d’églises se poursuivent (Auxerre, Rodez, église des Jacobins de Toulouse, cathédrale d’Albi).
Les rois de Majorque édifient une immense cathédrale à Palma, tandis qu'à l'autre extrémité de la Méditerranée les Lusignan élèvent la cathédrale de Famagouste.
L'Allemagne construit des églises en brique dans le Nord et répand dans le Sud les églises-halles à trois vaisseaux de même hauteur, dont le premier exemple est l'église de Schwäbisch Gmünd, commencée vers 1320. C'est là que débutent les Parler, dynastie d'architectes du xive s., qui s'illustrent au chœur de Fribourg-en-Brisgau, à celui de la cathédrale de Bâle, à la façade de Strasbourg et à Prague.
ARCHITECTURE CIVILE
L'architecture civile, surtout militaire au xiiie s., se développe dans les édifices publics des pays de civilisation urbaine : Palazzo Vecchio de Florence, Palais public de Sienne (bâti de 1297 à 1310), halle aux draps de Bruges (xiiie-xve s.).
En France, on fonde des villes nouvelles dans le Sud-Ouest, telles les bastides au tracé régulier de Monpazier ou de Grenade-sur-Garonne, on bâtit des ponts, comme le pont Valentré de Cahors, on construit des hôpitaux, comme celui de Tonnerre.
L'aspect le plus frappant de l'architecture civile du xive s. est le développement des châteaux et des demeures princières, de plus en plus accueillants, parce que, a-t-on dit, les progrès de l'artillerie rendent inutiles les lourdes défenses, mais aussi à cause de l'évolution des goûts et des mœurs. À Paris, on peut encore voir la grande salle basse du Palais, qui remonte à l'époque de Philippe le Bel, et, aux portes de la capitale, le château de Vincennes, où naquit Charles V.
Le Palais-Vieux des papes d'Avignon, construit avant 1346 par Pierre Poisson, est encore une forteresse ; le Palais-Neuf, achevé en 1360, avec sa salle de la Grande Audience et sa chapelle, est caractéristique d'un nouveau luxe, où se rencontrent influences italiennes et nordiques.
6.2. SCULPTURE
Dans les dernières années du xiiie s. s'établit un important chantier de sculpture à Notre-Dame de Paris pour le décor de la clôture du chœur. Mais la statuaire devient l'apanage des mécènes : statues de Vierges et de saints commandées par Enguerrand de Marigny pour Écouis ; œuvres de Jean Pépin d'Huy exécutées pour Mahaut d'Artois ; Vierge reliquaire du Louvre, objet précieux d'orfèvrerie et d'émaux fait à la demande de la reine Jeanne d'Évreux. Cette figure montre la grâce mélancolique que l'on retrouve sur les innombrables madones de pierre du xive s., le regard perdu, l'attitude « hanchée » pour accentuer la souplesse alanguie de la forme. Leur préciosité linéaire, souvent un peu sèche, se répète dans les gisants et se combine au réalisme des portraits funéraires, qui font leur apparition par exemple au tombeau des entrailles de Charles IV et de Jeanne d'Évreux par le sculpteur Jean de Liège.
6.3. PEINTURE
ITALIE
Dans la peinture, à Sienne, dès les premières années du xive s., Duccio allie dans sa fameuse Maestà les fonds d'or et l'irréalité byzantine à une notation subtile, fluide de l'espace, à des tons précieux, à une écriture souple. Simone Martini, auteur du Condottiere da Guidoriccio da Fogliano du Palais public de Sienne, est son héritier et se trouve à Avignon en 1340 pour décorer la porte de Notre-Dame-des-Doms. Matteo Giovannetti poursuit l'œuvre de Simone à Avignon, dans le décor du Palais-Neuf et à la chartreuse de Villeneuve. À Sienne même, les Lorenzetti cherchent une nouvelle expression de l'espace en développant les cadres architecturaux à l'intérieur de leurs peintures ainsi que les vastes premiers plans derrière lesquels se dressent des figures gracieuses.
FRANCE
En France, à Évreux et à Saint-Ouen de Rouen, les admirables vitraux à grands personnages surmontés de dais s'éclairent de jaune d'argent et scintillent sur des fonds de grisaille.
À Paris, Jean Pucelle, auteur, avec son atelier, des miniatures de la Bible de Robert de Billiyng (1327) et du Bréviaire de Belleville conservés à la Bibliothèque nationale, s'impose. Ses tons nuancés, son graphisme raffiné ne peuvent s'expliquer sans des contacts directs avec la peinture siennoise, mais, en même temps, il met à la mode les petites scènes naturalistes, qui se répandent dans les marges et dont l'art parisien avait déjà donné quelques exemples.
6.4. IMPORTANCE DU MÉCÉNAT PRINCIER
Les parents de Charles V, Jean le Bon et Bonne de Luxembourg, donnent l'exemple du mécénat princier. Le portrait de Jean le Bon (Louvre), peint peut-être par Girard d'Orléans, est le premier tableau de chevalet et le plus ancien portrait dans la peinture française. C'est aussi Jean le Bon qui commande la Bible de Jean de Sy (Bibliothèque nationale). C'est dans ce milieu royal que se forme le goût de Charles V pour le mécénat, de même que celui de son oncle, l'empereur Charles IV de Bohême, et celui de ses frères, les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne.
S'il ne reste rien du Louvre de Charles V, construit par Raymond du Temple, on connaît au moins un grand sculpteur de son temps, André Beauneveu, chargé de sculpter les tombeaux des premiers Valois, Philippe VI, Jean le Bon et Charles V, pour la nécropole royale de Saint-Denis. Son art réagit contre la sophistication des statues du début du siècle par un retour à la monumentalité et à la sobriété.
Charles V s'adressa à un autre sculpteur, anonyme, pour dresser deux statues de Saint Louis et de Marguerite de Provence à la porte d'une église de Paris. L'artiste les figura sous les traits de Charles V et de son épouse dans un style aussi dépouillé que celui de Beauneveu, avec encore plus de sensibilité dans l'expression de vive intelligence du roi. Ces deux statues, aujourd'hui au Louvre, ont été rapprochées des belles effigies de Jean de Berry, de sa femme, de Charles VI et d'Isabeau de Bavière qui décorent la cheminée de la Grande Salle du palais de Poitiers.
Charles V collectionnait les livres dans sa « librairie » du Louvre et fit travailler de nombreux peintres. Les Grandes Chroniques de France (Bibliothèque nationale) en gardent le souvenir, mais plus encore le Parement de Narbonne (Louvre), toile dessinée à l'encre, sur laquelle figurent Charles V et la reine en donateurs. C'est aussi à la fin du règne de Charles V qu'appartiennent les tapisseries de l'Apocalypse d'Angers, commandées par Louis Ier d'Anjou au lissier parisien Nicolas Bataille et au peintre Hennequin de Bruges. Il ne faudrait pas oublier que Charles V fut aussi amateur d'objets précieux. Son sceptre, au Louvre, très restauré, et la coupe du British Museum, décorée d'émaux, en restent des vestiges.
Un autre foyer se développe à Prague dans l'entourage de la cour de Bohême. Charles IV fait construire la cathédrale par Mathieu d'Arras, puis par Peter Parler. Toute une école d'enlumineurs illustre de remarquables manuscrits, comme le Passionnaire de l'abbesse Cunégonde, vers 1320, ou le Missel de Jean de Streda (Johann von Neumarkt), après 1350. Le Maître de Vyšší Brod peint tout un cycle sur panneaux, et, un peu plus tard, Maître Théodoric décore la chapelle du château royal de Karlštejn, de cent vingt-neuf peintures de saints et de prophètes. Ses figures sont massives et en même temps d'un dessin mou, qui, contrairement aux tendances générales de l'art du xive s., cède la prééminence à la couleur.
7. LA FIN DU MOYEN ÂGE
La seconde moitié du xive s. voit l'avènement de nouveaux styles dans l'architecture.
7.1. ARCHITECTURE
LE STYLE PERPENDICULAIRE
C'est en Angleterre que prend place la naissance du style perpendiculaire, qui s'éloigne de l'art gothique. Ce style apparaît dès le milieu du xive s., au chœur de la cathédrale romane de Gloucester, dont les parois latérales disparaissent derrière un réseau de panneaux de pierre découpés en rectangles. Le fond du chœur est remplacé par une immense verrière à fenestrage perpendiculaire. Les voûtes en éventail du cloître adjacent, élevées un peu plus tard, ont des supports dissimulés dans des niches qui tapissent les murs. Des triangles convexes partent de ces murs, s'arrondissent et se rejoignent sous un plafond plat, qui ne rappelle plus rien de la croisée d'ogives. Une broderie de motifs en léger relief couvre toute la voûte. Ce style, né dans l'ouest de l'Angleterre avant 1400, s'étend avec une vigueur nouvelle après la guerre des Deux-Roses. Il se manifeste dans l'architecture civile, à Oxford, à Cambridge, au palais d'Eltham. Il reparaît dans l'architecture religieuse, à Peterborough, et dans les grandes entreprises royales du début du xvie s., à la chapelle d'Henri VII à Westminster, où les voûtes en éventail se combinent avec des clefs pendantes, au cloître Saint Stephen de Westminster, œuvre de William Vertue et de Henry Redman, à Saint George's Chapel de Windsor, à la Chapelle de King's Collège à Cambridge, par John Wastell.
LE GOÛT DE L’ORNEMENTATION
L'exubérance du décor se retrouve ailleurs, sous d'autres formes. Elle prend un aspect particulier dans la Péninsule Ibérique, car les éléments gothiques s'y allient aux motifs de l'islām. Les « chapelles imparfaites » de Batalha, au Portugal, dès le milieu du xive s., déploient une végétation de pierre foisonnante qui semble croître dans une atmosphère de luxuriance tropicale. Cette richesse se retrouve à Belém, à la tour-lanterne de la cathédrale de Burgos, à l'Alhambra de Grenade et au palais de l'Infant à Guadalajara.
LE STYLE FLAMBOYANT
L'art flamboyant, en France et dans les pays du Nord et de l'Europe centrale, aime aussi la richesse décorative. Ainsi nommé à cause de l'usage qu'il fait des courbes et des contre-courbes, articulées en « soufflets » et « mouchettes », il apparaît à la fin du xive s.
Gui de Dammartin, architecte de la Sainte-Chapelle de Riom, paraît en avoir été l'un des initiateurs. La structure des voûtes sur croisée d'ogives ne disparaît pas comme en Angleterre, mais les nervures se multiplient, s'entrecroisent, se recoupent avec une grande fantaisie et s'enrichissent de clefs pendantes. Le même esprit inventif préside aux plans et aux élévations des églises, tantôt à nef unique, tantôt à trois vaisseaux d'inégale hauteur, tantôt églises-halles. Les murs reprennent de l'importance entre les ouvertures. Les piles se creusent, ondulent, se modèlent d'arêtes à angles vifs et montent d'un seul jet jusqu'aux voûtes, dans lesquelles elles se fondent. Les fenêtres s'ornent de réseaux flamboyants. La brisure des arcs s'assouplit, s'abaisse en anse de panier, se redresse en accolade.
Aux portails, la statuaire disparaît presque, étouffée par les socles, les dais, les gables et les pinacles ajourés et fouillés. Les motifs végétaux, feuilles piquantes, choux frisés, se découpent en un relief aigu et tourmenté. Les balustrades, les arcs-boutants perforés et contournés accroissent encore cette luxuriance décorative, qui alterne avec des pans de mur nu. Cet art connaît une faveur particulière en Normandie et dans le nord-ouest de la France : à Gisors, à Louviers, à Lisieux, à Saint-Maclou de Rouen, à Saint-Pierre de Caen, au chœur du Mont-Saint-Michel, à Saint-Vulfran d'Abbeville, à Rue, à Saint-Riquier ; mais il se répand partout : à Chartres, à la flèche de Jean de Beauce ; à Paris, à Saint-Séverin et à Saint-Gervais ; dans l'Est, à Notre-Dame-de-l'Épine, près de Châlons-sur-Marne, à Saint-Nicolas-de-Port ; sur la Loire, à Vendôme et à Cléry ; en Bresse, à la somptueuse église de Brou ; dans le Sud, au porche de la cathédrale d'Albi.
Le style flamboyant apparaît aussi en Allemagne à la fin du xive s., à Ulm, sous la direction d'Ulrich von Ensingen, qui construit peu après la flèche de la cathédrale de Strasbourg, terminée par Johannes Hültz. Saint-Jacques de Liège, la cathédrale d'Anvers, l'église de Bois-le-Duc cèdent à l'exubérance du décor, tandis que Notre-Dame de Halle, les églises de Leyde et de Dordrecht conservent une grande sobriété.
L'architecture civile adopte aussi les nouvelles formes, à l'hôtel Jacques-Cœur de Bourges, au palais de Justice de Rouen ou aux hôtels de ville du Nord, de Douai, de Compiègne, de Bruxelles ou d'Oudenaarde, avec leurs orgueilleux beffrois. Le château de Tarascon, les premiers châteaux de la Loire, Langeais, Loches, Chaumont, Châteaudun, Amboise, rappellent ce que furent les demeures princières de la fin du Moyen Âge.
7.2. SCULPTURE
À la cour de Bourgogne, au moment même où fleurit le « gothique international », Claus Sluter, originaire de Haarlem, apporte une vigueur et un pathétisme neufs à la sculpture. À Dijon, le portail de la chartreuse de Champmol et le calvaire du cloître de celle-ci, plus connu sous le nom de « puits de Moïse », révèlent une impétuosité dramatique, une plasticité des vêtements gonflés et cassés aux pieds, une recherche d'expression pathétique. La violence et le sens théâtral de cet art transforment la sculpture du xve s., et son écho résonne jusque dans la peinture des grands maîtres flamands. En Bourgogne même, Claus de Werve (vers 1380-1439), Jacques Morel, Juan de La Huerta (?-vers 1462), Antoine Le Moiturier continuent l'œuvre de Sluter.
Les thèmes douloureux se répandent, comme celui de la Mise au tombeau, traité vers 1453 à Tonnerre par Jean Michel et Georges de La Sonnette. Ce thème est repris bien des fois, à Monestiès-sur-Cérou par exemple, à Solesmes à la fin du siècle, dans un décor déjà italien. La Pietà, ou Vierge de pitié qui reçoit sur les genoux le corps du Christ mort, est un autre sujet dramatique souvent représenté à la fin du Moyen Âge, comme le sont les Crucifixions tragiques. Parmi les grands ensembles sculptés, il faut citer les portails de la cathédrale de Rouen, où travaillent Pierre Desaubeaux, Roland Leroux et Nicolas Quesnel, les statues de la chapelle de Châteaudun et la clôture du chœur de la cathédrale d'Albi, où se mêlent des influences bourguignonnes et d'autres venues de la Loire. Dans cette dernière région, en effet, la véhémence de Sluter s'adoucit et l'élégance sereine des sculpteurs de l'entourage de Charles V persiste. Ces tendances se notent au tombeau d'Agnès Sorel à Loches, dans la sainte Madeleine de l'église Saint-Pierre de Montluçon ou la Vierge du Marthuret de Riom, et plus encore chez Michel Colombe (tombeau des parents d'Anne de Bretagne à la cathédrale de Nantes). La région de Troyes se rattache encore à l'art gothique au xvie s., avec le Maître de sainte Marthe (église Sainte-Madeleine de Troyes), dont on retrouve la sobre expression de douleur dans la Pietà de Bayel et les Mises au tombeau de Villeneuve-l'Archevêque et de Chaource ; la Lorraine aussi, avec Ligier Richier.
La sculpture italienne se tourne dès 1400 vers la Renaissance, mais, dans les pays germaniques, on sculpte des retables de bois, en Rhénanie à Oberwesel ou à Marienstatt, à la fin du xive s., en Autriche à Sankt Wolfgang, non loin de Salzbourg, en 1471-1481. Le retable de Cracovie, par Veit Stoss, celui de Creglingen, par Tilman Riemenschneider, sont célèbres. À Anvers, à Bruxelles, des ateliers de retables sculptés, fourmillant de personnages, connaissent un grand succès.
L'Espagne est prodigue de sculpteurs. Des étrangers y travaillent, mais un art particulier s'y développe, empreint d'une fierté et d'une dignité propres à la Péninsule. Il faut mentionner le tombeau de Jean II et d'Isabelle de Portugal à la chartreuse de Miraflores ou le retable de sainte Anne à la cathédrale de Burgos parmi de nombreuses œuvres d'excellente qualité.
En Angleterre, à côté des reliefs en albâtre un peu commerciaux, on rencontre de très beaux monuments de bronze, comme le tombeau de Richard Beauchamp, à Warwick, par William Austen.
7.3. PEINTURE
En peinture, à la suite du grand courant international de la fin du xive s., les artistes se distinguent par leur nombre et par leur valeur.
Dans les pays du Nord, c'est l'explosion de l'art flamand, dont il suffit de rappeler les principaux interprètes : Robert Campin, Van Eyck, Van der Weyden, puis Bouts, Van der Goes, Memling. Les recherches de profondeur spatiale, d'atmosphère transparente, de luminosité marquent cette peinture, qui se dégage du microcosme de l'enluminure, tout en conservant le goût du détail et de l'ornement. Les compositions religieuses, les portraits réalistes, l'univers fantastique de Jérôme Bosch se succèdent. La moisson des chefs-d'œuvre flamands du xve s. influence la production artistique des autres pays et se répercute jusqu'en Italie, dans les milieux florentins les plus évolués.
Cette influence est particulièrement sensible en Espagne – qu'a visitée Van Eyck – , chez Lluís Dalmau (Vierge aux conseillers, Barcelone), chez Jaume Huguet ou chez le Maître de la Seo de Urgel. Les peintres les plus remarquables demeurent Bartolomé Bermejo (Pietà), Pedro Berruguete, qui mêle des expériences italiennes aux influences flamandes dans le Retable de sainte Eulalie, et, au Portugal, Nuño Gonçalvez avec le Retable de São Vicente.
L'art germanique, avec Stephan Lochner à Cologne, Lukas Moser, Hans Multscher et Konrad Witz dans le Sud, assimile les leçons flamandes et aboutit aux œuvres de Martin Schongauer et de Friedrich Herlin, qui annoncent les maîtres du xvie s.
La France aussi possède de grands peintres au xve s. Simon Marmion, le Maître de saint Gilles sont très influencés par l'art flamand, mais Jean Fouquet va beaucoup plus loin, dans l'enluminure comme dans les tableaux. Il allie dans un art très personnel les ordonnances et les tonalités italiennes à la fluidité atmosphérique nordique. Il faut en dire autant d'Enguerrand Charonton et du Maître de la Pietà d'Avignon, qui retrouvent dans leurs compositions la monumentalité des tympans des grandes cathédrales.
L'art du vitrail est particulièrement bien représenté à Rouen et à Strasbourg avec Pierre d'Andlau. Il faudrait encore parler de la tapisserie, qui fleurit à Arras, à Bruxelles et qui, à l'aube de la Renaissance, donne les tentures mille-fleurs, et aussi des trésors d'orfèvrerie, comme celui de la Toison d'or à Vienne.
Ce n'est donc pas un art moribond et décadent que la Renaissance est venue supplanter, mais un art très vivace, qui ne cessait de se renouveler depuis la création de Suger à Saint-Denis.
8. LE GOTHIQUE INTERNATIONAL
À la fin du xive s. se répand dans toute l'Europe occidentale, surtout dans la peinture, le style gothique international. C'est un art raffiné, si élégant qu'on l'a qualifié parfois de « maniéré », dans lequel les formes s'étirent, les lignes se courbent en une écriture compliquée, qui aime les couleurs rares et la somptuosité de l'or. Art de cour et de luxe, parfois artificiel, qui, pourtant, observe la nature, développe les recherches spatiales, le paysage et le portrait, il est lié aux mécénats princiers de la fin du xive s. et disparaît dès les années 1415-1420.
La peinture siennoise des Lorenzetti est à l'origine de ce style, qui prend son essor en Italie avec les Gaddi, Antonio Veneziano (actif de 1369 à 1388) et Lorenzo Monaco (vers 1370-vers 1422), dont la grâce et les couleurs vives se perpétuent au début du xve s. chez Sassetta et Gentile da Fabriano (vers 1370-1427). En Lombardie, Giovannino De'Grassi se révèle un extraordinaire animalier et, à Vérone, Pisanello exprime toute la préciosité, réaliste dans son observation, fantastique dans ses inventions, du gothique international. Au même moment, à Florence, Masaccio s'engage dans les voies de la Renaissance.
L'influence siennoise se répand de bonne heure en Espagne, vers 1380 en Catalogne avec Lluís Borrassá, puis avec Ramon de Mur et Bernat Martorell, à Majorque avec le Maître de sainte Eulalie et le Maître de Montesión, à Saragosse avec Zaortiga, à Valence avec Marzal de Sax.
L'Allemagne n'échappe pas à ce courant international, que l'on rencontre à Hambourg chez Maître Bertram, auteur du retable de l'église Saint-Pierre, et chez Maître Francke, à Dortmund chez Konrad von Soest. Il apparaît même en Bohême chez le Maître de Trebon, qui combine le graphisme élégant des silhouettes à des détails réalistes, avec des couleurs vives qui émanent d'une sorte de clair-obscur.
Les Pays-Bas participent au mouvement général, mais se trouvent liés à la Bourgogne par le mariage du plus jeune frère de Charles V, Philippe le Hardi, à Marguerite de Flandre, et c'est à Dijon qu'on trouve les peintures les plus caractéristiques, celles de Melchior Broederlam, originaire d'Ypres, auteur des volets peints du retable de la chartreuse de Champmol. À sa suite, Jean de Beaumetz (?-1396) exprime un art plus violent et plus dur.
En Angleterre, le Diptyque Wilton demeure le seul témoin important de cet art de cour.
À Paris, on rencontre des artistes souvent venus du Nord. Ainsi, Jean Malouel (vers 1370-1419), né à Nimègue, peint, avant son départ pour la Bourgogne en 1397, le Martyre de saint Denis , terminé par Henri Bellechose (?-vers 1445). Jacquemart de Hesdin entre au service du duc de Berry, termine peut-être le Psautier du duc, commencé par le sculpteur Beauneveu, et décore les Très Belles Heures de Bruxelles dans un style où se reconnaissent le souvenir de Jean Pucelle et l'influence d'Ambrogio Lorenzetti, notamment dans les compositions spatiales.
Les artistes les plus célèbres de la cour de Jean de Berry, les frères Limbourg, viennent de Nimègue, comme Malouel, dont ils sont les neveux, et voyagent dans toute l'Europe avant de se fixer en Berry. Ils incarnent le gothique international dans les miniatures des Très Riches Heures du duc de Berry (Chantilly). Ils imitent les Siennois dans la grâce calligraphique et la recherche de profondeur ; ils y mêlent observation naturaliste et fantaisie du décor, portraits de grands seigneurs et pays idéalisés.
Trois miniaturistes du début du xve s. participent encore au courant international : le Maître des Heures de Boucicaut , le Maître du Bréviaire de Bedford et le Maître des Heures de Rohan .
bjets précieux. La plupart ont disparu, mais le Petit cheval d'or d'Altötting (Bavière) en donne encore quelque idée. Les Vierges sculptées de Bohême, relevant du « beau style », peuvent être aussi rattachées au gothique international, de même que le Couronnement de la Vierge sculpté au-dessus de la porte du château de La Ferté-Milon. Ces sculptures précieuses font suite aux Vierges italiennes de Nino Pisano.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'ART ROMAN |
|
|
| |
|
| |
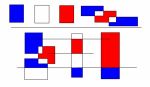
art roman
(ancien français romanz, langue vulgaire, du latin populaire *romanice, à la façon des Romains)
Cet article fait partie du dossier consacré au style.
Se dit de l'art qui s'est épanoui en Europe occidentale aux xie et xiie s.
Le style roman caractérise une production artistique élaborée en Occident jusqu'à la fin du xiie s., et avant tout une architecture religieuse dont les formes s'établissent de façons diverses dans toute l'Europe, au moment où, vers l'an mille, la chrétienté connaît, après les invasions des Hongrois, des Sarrazins et des Normands au xe s., une ère nouvelle de prospérité.
Très rapidement supplanté par le style « gothique », dans l'Île-de-France et le Nord à partir de la moitié du xiie s., puis dans toute l'Europe occidentale, l'art roman, et plus largement la période médiévale, se voient méprisés par la Renaissance et les siècles classiques. Déprédations, mutilations, démolitions se multiplient comme à Cluny, transformé en carrière de pierres de 1798 à 1823.
La réhabilitation de l’art roman débute au xixe s. mais, bien que l'invention de l'expression art roman remonte au moins à 1818, longtemps encore le nouveau prestige du Moyen Âge se concentre sur le « siècle des cathédrales », donc sur le xiiie s., gothique. Le mythe du progrès aidant, l'art roman ne semble alors être qu’une ébauche – volontiers jugée « gauche et maladroite » ou, au mieux, « naïve » – de ce qui s'épanouira dans le gothique. C'est à partir de 1930 seulement qu'Henri Focillon (1881-1943) entreprend d'étudier l'art roman comme un « style » distinct, valant pour lui-même.
1. LE STYLE ROMAN
1.1. CONTEXTE HISTORIQUE
Historiquement, l'époque romane correspond à la montée du pouvoir capétien. Sacré en 987, Hugues Capet règne sur l'Île-de-France et l'Orléanais. Ses premiers descendants étendront le pouvoir royal aux provinces voisines, tout en mettant lentement en place le système féodal. Après le sombre xe s. s'ouvre une ère de grands défrichements. Avec la progressive stabilisation politique et l'essor démographique, le renouveau économique retentit immédiatement sur l'art, et notamment sur l'architecture. À la suite du fils de Hugues Capet, Robert le Pieux, qui fonde nombre de monastères, on restaure les vieilles églises du haut Moyen Âge, détériorées par les invasions normandes ; bien souvent, on les détruit pour les reconstruire au goût du jour. Les édifices majeurs sont radicalement transformés, les églises de campagne, jusque-là souvent en bois, sont désormais bâties en pierre. Un chroniqueur bourguignon, Raoul Glaber (fin du xe s.-vers 1050), décrit le phénomène : « Comme approchait la troisième année qui suivit l'an mille, on vit dans presque toute la terre, mais surtout en Italie et en Gaule, réédifier les bâtiments des églises; bien que la plupart, fort bien construites, n'en eussent nul besoin, une véritable émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que celle des voisins. On eût dit que le monde lui-même se secouait pour dépouiller sa vétusté et revêtait de toutes parts une blanche robe d'églises. Alors, presque toutes les églises des sièges épiscopaux, les sanctuaires monastiques dédiés aux divers saints, et même les petits oratoires des villages furent reconstruits plus beaux par les fidèles. »
Force est de constater que, en dépit des reconstructions ultérieures, des centaines d'églises romanes sont encore visibles en Europe.
1.2. LE PREMIER ART ROMAN
Le passage du haut Moyen Âge à l'âge roman ne s'est pas opéré brutalement. Une architecture de transition, empreinte des habitudes ancestrales de construction, est riche de traits innovants. Ce premier art roman présente des caractères différents dans les régions méridionales et dans le Nord.
LE NORD
Tradition architecturale
On connaît mal l'architecture du haut Moyen Âge dans la partie nord de la France actuelle, mais il semble que les églises de l'an mille en reprennent certains traits : absence de voûtement, construction en petit appareil bien posé en assises régulières ou en moellons ordonnés en arête de poisson. De très nombreuses petites églises de village, d'une extrême simplicité de construction, sont faites d'une grande salle rectangulaire prolongée à l'est par une abside ou un chevet plat, leur éclairage étant assuré par de rares fenêtres seulement ébrasées vers l'intérieur. Le monument n'est jamais voûté, mais toujours couvert par une charpente très simple ; seule l'abside peut être couverte d'un cul-de-four. Dans quelques cas s'intercale entre la nef et le chœur une petite tour carrée. Il s'agit vraisemblablement d'un modèle architectural hérité des périodes antérieures, qui persistera longtemps en milieu rural. On retrouve cette manière de construire des églises de village encore au xiiie s., en pleine période gothique.
Dans les agglomérations un peu plus importantes, on bâtit des édifices identiques, mais aux dimensions plus généreuses. Il est rare que l'on connaisse les chœurs qui y étaient associés, ceux-ci ayant été presque toujours reconstruits.
Dans les édifices plus ambitieux, la nef est plus vaste et comporte un vaisseau central séparé des bas-côtés par des arcades en plein cintre reposant sur de gros piliers rectangulaires. Le transept est souvent large et ouvre sur un chœur à une ou trois absides. Peu après l'an mille apparaissent les premiers chœurs à déambulatoire (Notre-Dame-de-la-Couture au Mans, Saint-Martin de Tours).
Le clocher, s'il est unique, se rencontre volontiers à la croisée. S'il y en a plusieurs, ils peuvent être placés devant la façade, la base servant de porche, ou de part et d'autre du chœur. On note que les fenêtres sont beaucoup plus petites qu'à la période précédente, ce qui assombrit donc l'église.
Bien que chaque édifice soit unique, on ne constate pas alors la « régionalisation » du style, comme ce sera le cas plus tard. La manière de construire, le traitement des volumes sont assez homogènes, le modèle stylistique étant très largement diffusé. Probablement, sauf pour les édifices les plus importants, la construction est alors le fait d'artisans locaux, voire de la population elle-même. Cette architecture est assez simple pour être exécutée sans autre plan que l'implantation au sol du tracé des murs. De fait, la construction relève plus de la simple maçonnerie que d'une véritable démarche architecturale, au sens moderne du terme.
Prémices de l’art roman
Portonovo, l'abbatiale Santa Maria di Portonovo
À côté de cette construction simple héritée du passé se développe autour de l'an mille une architecture qui annonce déjà le roman, comme à l'abbatiale de Montier-en-Der (Haute-Marne), commencée entre 960 et 980. Ces édifices sont notamment liés au mécénat royal du début du xie s. et subsistent peu nombreux. La tour-porche de Saint-Germain-des-Prés, la cathédrale et les cryptes de Saint-Avit et de Saint-Aignan d'Orléans, la chapelle octogonale de Senlis, la chapelle Saint-Jean-Baptiste d'Argenteuil, l'abbatiale de Tournus en sont quelques exemples. Ce sont des constructions d'aspect solide, aux murs épais, renforcés au-dehors par des contreforts et au-dedans par des pilastres soutenant des voûtes en berceau ou, le plus souvent, d'arête. Le moyen appareil taillé, monté avec des joints de mortier très épais, n'y est pas rare.
Ces édifices témoignent, peu après l'an mille, d'un nouveau courant architectural encouragé par le souci des grands abbés et des évêques de construire pour leur cité ou leur monastère le plus beau des sanctuaires. Émulation qui contribue au lancement de grands programmes de construction, souvent très lourds financièrement, et parfois facteurs de discorde au sein des communautés religieuses. Certains abbés seront accusés par leurs moines de dilapider le patrimoine au bénéfice d'une trop belle église. À Saint-Remi de Reims, les parties basses révèlent le projet grandiose et novateur de l'abbé Airard vers 1015, que ses successeurs seront contraints d'achever d'une manière moins ambitieuse. Il semble pourtant que, dans le domaine royal tout au moins, cet élan ait été coupé, probablement en raison de la situation politique difficile sous le règne de Henri Ier (1031-1060). La construction ou la restauration d'églises paraît redémarrer dans le dernier tiers du xie s., sur les bases définies un demi-siècle plus tôt.
LE SUD
Très influencé par l'Italie du Nord, le premier art roman méridional met exclusivement en œuvre la construction en moellons disposés en appareil régulier. Les églises peuvent être à trois nefs, avec un très large transept et un chevet échelonné pour les grands édifices ; les petites églises rurales sont plutôt à nef unique, prolongée par une petite abside. Cette architecture gagnera la Suisse et la région rhénane, puis la Bourgogne et la Catalogne, où se rendent des maçons lombards. De là, elle se répandra le long de la Méditerranée et en Espagne. Un décor mural particulier l'accompagne souvent. Il s'agit de festons de petits arcs soutenus à intervalles réguliers par de minces contreforts appelés lésènes. L'ensemble forme une bande lombarde. Son rôle décoratif est évident, par le jeu des ombres portées sous le soleil. Mais elle participe également à la stabilité du monument en aidant au soutien des murs. Elle permet, à portée égale, de construire des murs moins épais. On la trouve généralement associée à des parties non voûtées des édifices.
Les clochers prennent une grande importance, notamment en Catalogne. Ce sont de hautes tours carrées à plusieurs niveaux de baies, décorées à l'extérieur de bandes lombardes. Il s'agit souvent de clochers latéraux. Celui de Saint-Martin-du-Canigou ou les deux clochers (dont un seul subsiste) élevés aux extrémités du transept de Saint-Michel-de-Cuxa sont particulièrement remarquables.
1.3. LE SECOND ART ROMAN
Si la première période romane montrait une grande homogénéité stylistique, de telle sorte qu'on pouvait la diviser seulement en deux grands ensembles, méridional et septentrional, la seconde période paraît plus disparate. Au xixe s., dès les premiers travaux d'histoire de l'architecture médiévale, on tentera de clarifier la pensée en formulant une théorie des écoles régionales : Bourgogne, Poitou-Saintonge, Provence, Normandie… S'il est vrai que des tendances stylistiques se dégagent nettement dans telle ou telle région, sous l'influence d'un grand monument local, ces tendances n'ont jamais de limites géographiques définies. Tout au plus peut-on, au prix d'un grand effort documentaire, estimer l'aire de diffusion de telle ou telle caractéristique technique ou décorative, et jamais ce territoire ne correspond à une division politique. C'est pourquoi on abandonne aujourd'hui ce classement trop rigide au profit d'un raisonnement plus souple, en observant qu'en quelques lieux travaillent des équipes dynamiques faisant œuvre d'originalité. C'est notamment le cas en Normandie, en Bourgogne et en Catalogne. Ailleurs, c'est un grand édifice qui peut être l'élément déterminant, en servant d'exemple pour les constructions postérieures. On constate que les techniques ou les décors se diffusent à grandes distances, selon des lois que les chercheurs ont souvent du mal à comprendre. Les hommes du Moyen Âge, notamment les artisans maçons, les grands abbés ou les évêques bâtisseurs, voyagent beaucoup et sont probablement marqués par certaines réalisations lointaines. L'architecture romane n'évolue donc pas de façon linéaire mais dans un foisonnement permanent.
2. LE RÉPERTOIRE ROMAN
2.1. LES VOÛTES
Les techniques de construction évoluant, l'économie se développant, les églises sont dotées de voûtes sur les chœurs, sur les transepts et sur les nefs. Leur généralisation modifie profondément l'aspect des églises. La première période n'avait connu que des voûtes en cul-de-four sur les absides, des voûtes d'arêtes sur les très petits édifices ou les bas-côtés dans le Nord, de rares voûtes en berceau sans doubleau dans le Sud (celle de l'église basse de Saint-Martin-du-Canigou est célèbre). La véritable architecture romane se reconnaît à son articulation. On a coutume en effet d'associer à chaque retombée de voûte, à chaque arc, un support particulier. Les parois nues des édifices sont désormais rythmées par les retombées de voûtes. Celles-ci peuvent être de simples pilastres plats longeant le mur ou bien des demi-colonnes engagées dans le mur. Les parois sont ainsi divisées en quartiers qui marquent les travées. Les voûtes sont dans un premier temps lourdes et trapues, obligeant les constructeurs à prévoir des supports très massifs pour contenir les poussées. Progressivement, ces voûtes s'affinent, et, de plus en plus légères, permettent de créer des édifices plus hauts, plus élégants. Mais la portée de ces voûtes reste limitée, déterminant ainsi des nefs plus étroites que précédemment.
2.2. LA COUPOLE
Un mode de voûtement hérité de l'Antiquité romaine aurait pu donner lieu à quelques grandes réalisations, mais, trop difficile à mettre en œuvre, il n'a finalement que rarement été utilisé : c'est la coupole. On la trouve souvent sous les tours, à la croisée des transepts, mais elle peut aussi couvrir de vastes nefs, comme à la basilique Saint-Front de Périgueux, à la cathédrale d'Angoulême ou à Souillac. Le voûtement en files de coupoles impose un très fort contrebutement qui alourdit l'édifice, de telle sorte que c'est finalement la voûte d'ogive qui s'imposera.
2.3. L’ARC BRISÉ ET L’OGIVE
Lorsque le style gothique apparaît en Île-de-France, vers 1140, à la façade de l'abbaye de Saint-Denis, l'architecture romane est à son apogée. Elle ne disparaît pas immédiatement. Au contraire, elle se perpétue, même autour de Paris, jusqu'à la fin du xiie s. au moins. Le passage du roman au gothique n'est pas un phénomène brutal mais l'effet d'une mutation continue. Par exemple, l'art gothique, qu'on caractérise par la présence de l'arc brisé et de l'ogive, n'en détient pas le monopole. On retrouve ces éléments dans l'art roman terminal.
On sait que l'arc brisé n'est pas un critère déterminant du gothique, puisqu'il est présent dès la fin du xie s. en Bourgogne, dans des édifices indubitablement romans. D'autre part, l'ogive n'est dans un premier temps qu'un renfort supplémentaire en forme de deux cintres non brisés à l'origine qui se croisent au centre de la voûte et s'appuient sur des colonnettes, le plus souvent aux angles. L'ogive s'applique prioritairement sur des voûtes d'arêtes. Les plus anciennes croisées d'ogives, de Lombardie ou du sud de la France (à l'abbaye de Caunes-Minervois, par exemple), apparaissent à la fin du xie s. Ce sont alors de robustes constructions, des arcs de section rectangulaire soutenant des voûtes particulièrement épaisses. Elles ne soutiennent pas vraiment la voûte mais font corps avec elle. Rapidement, dès le début du xiie s., les ogives se font élégantes, moulurées, plus fines, à mesure que la voûte s'amincit. Les retombées des ogives participent à l'articulation des volumes de l'église et créent des piliers composés, entourés de nombreuses colonnettes. Pourtant, on peut considérer qu'il s'agit encore d'architecture romane. En effet, ce sont toujours les murs, larges et étayés par des contreforts, qui supportent l'ensemble du poids de la construction, et non encore les arcs. L'articulation n'est plus seulement horizontale, mais aussi verticale, car les étages se distinguent nettement sur les parois par des corniches, tant au-dedans qu'au-dehors.
2.4. LES CRYPTES
Si, apparues dès la période mérovingienne, elles se multiplient à partir du viiie s. après l'arrivée des Normands en Gaule, à l'époque romane elles prennent une forme et une fonction nouvelles. Initialement, ces cryptes étaient constituées d'une cavité enterrée contenant la relique d'un saint, à laquelle on pouvait accéder par un petit couloir rectiligne, long de quelques mètres à peine, qui débouchait sur une galerie annulaire épousant la forme de l'abside de l'église. Cette galerie s'ouvrait en surface, après une volée d'escalier, à l'est et à l'ouest du chœur. La crypte remplissait une fonction unique et précise : abriter une relique et la cacher à la vue de la population. Dans les monastères et dans les cathédrales, la crypte se trouvait toujours en clôture, c'est-à-dire dans la partie du monument réservée aux clercs. Parfois, une fenestella, petite fenêtre ouvrant sur le chœur, permettait aux laïcs d'apercevoir le sarcophage du saint.
Les invasions normandes ayant cessé, il n'est plus nécessaire de cacher les reliques. Cela se traduit dans l'architecture par une augmentation de la taille des cryptes, et par une modification de leur fonction : la crypte n'est plus une chambre forte, mais un reliquaire monumental qui met en valeur la relique et permet autour d'elle une circulation aisée. Vers la fin du xe s., pour les plus anciens cas connus, telle la crypte d'Évron, en Mayenne, apparaissent des cryptes-halles, dites aussi cryptes-salles. La crypte est encore souvent enterrée, ou semi-souterraine. Presque toujours, elle est éclairée par des fenêtres ouvrant sur l'extérieur du chevet. Il ne s'agit plus d'un simple couloir mais d'une salle plus ou moins importante, voûtée, soutenue par des files de piliers. Par commodité, on construit la crypte de telle sorte qu'elle serve aussi de fondation pour le chœur de l'église. Le développement des communautés monastiques accompagnant celui des chœurs eux-mêmes, les dimensions des cryptes augmentent également. Souvent, la crypte reprend les proportions de l'abside principale, mais quelquefois les constructeurs l'étendent à toute la partie orientale de l'église ; elle reproduit alors en sous-sol la forme du chœur à déambulatoire, comme à la cathédrale d'Auxerre ou à Tournus, ou celle du transept et des absides, comme à Montmajour. On y accède, selon les cas, par un escalier axial perçant le chœur à l'entrée de l'abside, ou par des escaliers latéraux ouvrant de part et d'autre du chœur, comme à l'abbaye Notre-Dame d'Argenteuil, ou, parfois, dans les bras du transept.
Si la crypte abrite toujours les reliques, tout est désormais organisé pour que l'on puisse aisément la visiter. Plusieurs fois dans l'année, les religieux y viennent en procession – les portes latérales servant l'une d'entrée, l'autre de sortie –, et le reliquaire est intégré dans une liturgie stationnale. D'autre part, la crypte devient une petite chapelle souterraine puisque des autels y sont aménagés. Des offices peuvent donc y avoir lieu. Dans certains édifices, la circulation est organisée de telle sorte que les laïcs puissent y pénétrer pour y faire leurs dévotions. C'est notamment le cas dans les grandes églises de pèlerinage, telle la cathédrale de Chartres, qui se développent à la même époque. On note que, contrairement au reste de l'église, on y découvre rarement des sépultures, la crypte ne servant normalement pas de nécropole: la seule tombe acceptée est celle du saint vénéré dans le sanctuaire.
C'est au xie s. et au xiie s. qu'on construira le plus de cryptes, le culte des reliques atteignant à ce moment-là une ampleur sans précédent. Pourtant, toutes les églises romanes n'en possèdent pas, loin s'en faut. Seule une faible proportion des édifices reçoit un tel aménagement, surtout les églises des monastères et des évêchés. Une crypte coûte cher parce qu'elle est difficile à construire et qu'elle doit être conçue pour soutenir durablement le poids du chœur de l'église. C'est donc une construction délicate, que toutes les communautés n'ont pas les moyens de payer. Lorsqu'elle existe, c'est le signe d'une situation économique locale favorable. On la trouve pourtant en milieu rural, dans de petites églises de campagne, autrefois siège d'un prieuré important ou d'une paroisse soutenue par un seigneur généreux. Bien souvent, la crypte est alors, avec l'abside, le seul espace voûté de l'édifice, par ailleurs simplement couvert d'une charpente.
2.5. LES MASSIFS OCCIDENTAUX
Ici encore, l'architecture romane est tributaire de la période antérieure. On sait que, dès l'époque paléochrétienne, on construisit contre la façade de certaines églises un porche, parfois surmonté d'une tour. À l'époque carolingienne, il était fréquent de doter les grands édifices d'un massif occidental (en allemand Westwerk), ensemble composé de deux fortes tours encadrant un corps de bâtiment plus bas qui comprenait un rez-de-chaussée avec un porche – la porte principale de l'église – et un étage. Le grand exemple de porche surmonté d'une tribune haute est la chapelle Palatine d'Aix-la-Chapelle, édifiée à la demande de Charlemagne pour son propre usage. La tribune, aisément reconnaissable à la large baie qui ouvrait sur la nef, servait, lors de la messe, de loge pour l'empereur, d'autres édifices possédant une tribune analogue à l'usage du seigneur ou de l'abbé. Dans d'autres cas, ce n'était pas une tribune qui était aménagée au-dessus du porche, mais une chapelle dotée d'un autel où étaient dits certains offices, notamment pendant les fêtes de Pâques.
Ces massifs occidentaux ont, dans le monde roman, deux descendances principales. Ils donneront naissance, à l'orée du gothique, aux façades harmoniques de nos cathédrales. On évoque la façade de Jumièges, construite au xie s. en Normandie, comme le premier cas réel de façade harmonique, dont les deux tours rondes, le porche et la tribune sont encore en parfait état.
Mais les constructeurs romans édifieront plus volontiers des tours-porches conservant, sous une forme plus simple, la fonction des Westwerke carolingiens. Ces tours-porches sont assez nombreuses. Elles se limitent à un unique corps de bâtiment plaqué devant la nef centrale de l'église, et comprennent, comme auparavant, un porche voûté, une tribune ou une chapelle à l'étage, et un ou plusieurs étages abritant les cloches. De plus en plus, la fonction de clocher prime sur la fonction liturgique de la chapelle, quand elle existe. Bien que certaines de ces tours-porches soient des œuvres magnifiques, comme à Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés ou Morienval, le modèle tendra à disparaître, au cours du xiie s., au profit de la façade.
2.6. LES CHEVETS
Jusque vers l'an mille, même les chevets des grands édifices étaient généralement composés d'une large et profonde abside. La liturgie nécessitant de nombreux autels, ceux-ci étaient dispersés dans toute l'église. Mais un modèle architectural proposé par Cluny change l'aspect des églises et leur utilisation. Les autels nécessaires à l'adoration permanente pratiquée dans la grande abbaye bourguignonne sont maintenant rassemblés à l'est, au chevet de l'église. La nef est désormais libre, les autels, placés dans de petites absidioles, prolongent les bras du transept et l'abside principale, créant un « chevet échelonné ». La dernière église de Cluny, dite Cluny III, la plus grande église de la chrétienté d'alors, construite au xiie s., montre l'aboutissement de la formule. Deux transepts successifs, un grand et un petit, sont entourés d'absidioles, et d'autres petites absides sont disposées autour d'un chœur à déambulatoire.
3. LES GRANDS TYPES D’ÉDIFICES
3.1. LES MONASTÈRES
Les moines ont tant construit durant la période romane qu'on a parfois associé abusivement l'architecture romane au monde monastique. Mais il est vrai que les grandes réalisations sont souvent le fait de communautés religieuses, seules capables, par leur puissance économique, de les financer.
L'organisation autour d'un cloître date du haut Moyen Âge. Les plus anciens exemples connus remontent au ixe s. Mais c'est seulement à l'époque romane que, à Cluny, se fixe pour longtemps le modèle de plan monastique qui se répandra bientôt à travers l'Europe. Le carré claustral est en clôture, c'est-à-dire que les laïcs ne peuvent pas y pénétrer. Le cloître est à la fois un jardin médicinal et d'agrément, un lieu de repos et de méditation, et une galerie de circulation distribuant les différents bâtiments nécessaires à la vie du monastère. Il est généralement placé au sud de l'église, la galerie sud s'appuyant sur celle-ci. En effet, un meilleur ensoleillement est recherché.
À l'est, la galerie permet d'accéder à la salle du chapitre, souvent construite dans la continuité du bras du transept. C'est la salle de réunion du monastère, au sol presque toujours plus bas que celui du cloître ; on y pénètre par un portail monumental à arcades. Dans le prolongement est aménagée une salle de travail. C'est là que se trouve le scriptorium, c'est-à-dire l'atelier d'écriture, dans les grands monastères. En effet, la cuisine toute proche, dans l'angle sud-est du cloître, permet, tout en travaillant, de bénéficier de la chaleur du feu. Les dortoirs sont installés au-dessus de la salle capitulaire et de la salle de travail. Ils communiquent, par un escalier, avec l'intérieur de l'église afin que les moines puissent rejoindre rapidement le chœur lors des offices de nuit. Le cloître est longé au sud par le réfectoire. Lorsque le bâtiment comporte un étage, on y trouve généralement la bibliothèque. À l'ouest du cloître sont rassemblées les activités domestiques : atelier, cellier, cave.
Le cloître est un des lieux privilégiés d'expression artistique, puisque la colonnade, initialement construite pour soutenir un auvent protecteur du soleil et de la pluie, est très tôt ornée. Y sont décorés les bases, les chapiteaux, les tailloirs, parfois les colonnettes et les pilastres. Certains cloîtres ne présentent qu'une sculpture ornementale, d'autres abritent de nombreuses scènes figurées d'inspiration religieuse. La galerie, dans un premier temps charpentée, est par la suite voûtée. Il existe quelques cas de double cloître, c'est-à-dire de galeries superposées liées à une église, elle aussi à deux niveaux, comme à Saint-Martin-du-Canigou.
3.2. LES ÉGLISES DE PÈLERINAGE
L'époque romane est aussi celle du plus grand développement des pèlerinages.
Outre ceux d'envergure régionale, fort nombreux, trois lieux attirent toute la chrétienté : Jérusalem, siège du tombeau du Christ, Rome, où l'on vénère saint Pierre, Compostelle, où est découverte au ixe s. la tombe de l'apôtre Jacques le Majeur. Au haut Moyen Âge, les difficultés économiques et l'instabilité politique entravent l'essor des grands pèlerinages. Mais à partir de l'an mille, des milliers de personnes de toutes conditions prennent la route, permettant la mise en place du réseau économique le plus spectaculaire du Moyen Âge. De ces trois lieux de culte, Rome et Compostelle sont les plus fréquentés. En France, c'est surtout la route de Saint-Jacques qui marque le paysage. Des routes de pèlerinage s'établissent, avec leurs relais, leurs hôpitaux, leurs églises.
Quelques grands sites, lieux de vénération d'une relique importante, servent de points de ralliement. L'afflux des pèlerins permet bientôt, dès le xie s., d'y édifier d'immenses églises, aptes à accueillir un public particulièrement nombreux.
Ce sont parmi les plus grandes de l'époque : Notre-Dame de Chartres, Saint-Martin de Tours, la Madeleine de Vézelay, Saint-Sernin de Toulouse, et Saint-Jacques de Compostelle. On peut considérer qu'il s'agit d'églises romanes classiques, dont n'étonnent ni les proportions ni les techniques de construction, mais leurs dimensions sont le double de la normale. On y trouve, pour qu'elles soient plus vastes encore, des doubles bas-côtés, portant à cinq le nombre des nefs. Au besoin, les bas-côtés se perpétuent dans le transept. Les chœurs sont immenses, à déambulatoires et chapelles rayonnantes. Ces églises majeures ont pour l'architecture un rôle moteur, les innovations qui y sont faites rejaillissant sur les édifices de moindre importance, et la circulation des voyageurs favorisant la diffusion des styles.
4. LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
On note un net progrès technique entre les constructions du haut Moyen Âge et celles de l'époque romane. De moins en moins, les monuments sont réalisés à partir de morceaux de réemploi. La pierre, même dans les églises modestes, est essentiellement extraite de carrières. Il s'agit souvent de matériaux locaux, moellons ou pierre de taille. Le moellon reste le plus utilisé durant la première période, soit essentiellement le xie s. Mais, dans la tradition du siècle précédent, le mur est monté assise par assise, donnant aux parois un aspect ordonné. Souvent, et en particulier dans les édifices les plus anciens, on reconnaît l'appareil en épi ou en arête de poisson. Les parois sont lisses, rarement rythmées par des contreforts, puisque les édifices ne sont en général pas voûtés. Les parties portantes des bâtiments, piliers, angles de murs, contreforts, encadrements de fenêtres ou de portes, arcs, sont le plus souvent renforcées par l'emploi de moyen appareil.
Le moyen appareil est parfois présent dans l'architecture carolingienne, mais il devient une caractéristique commune à la plupart des églises construites à partir de la fin du xie s., du moins dans toutes les régions où le sous-sol conserve des roches propres à la construction : calcaires et grès. Dans les régions pauvres en pierre, le moellon restera très employé durant tout le Moyen Âge et au-delà, seules les parties portantes étant en appareil taillé. Le moyen appareil correspond à un module de pierre taillée, facilement manipulable à bras d'homme. En effet, les constructeurs romans utilisent probablement peu d'engins de levage, et il leur faut cependant hisser les matériaux jusqu'au sommet des édifices, pourtant très hauts. Des échelles et quelques palans suffisent pour une construction à base de mortier et de pierres d'une vingtaine de kilogrammes. Ces pierres sont taillées au pic ou au poinçon, qui laissent sur la surface des traits caractéristiques. Elles sont vraisemblablement taillées sur le chantier et non en carrière, d'où on se contente d'extraire des blocs grossièrement équarris.
La mise en œuvre de ce moyen appareil évolue au cours de la période romane ; vers l'an mille, dans les exemples les plus anciens, l'équarissage est imparfait, les angles sont peu francs, et les joints de mortier très épais: parfois plus de 4 cm. Progressivement, la taille s'améliore et les joints s'amincissent. À la fin de la période, les angles sont vifs, et les joints très minces : moins de 1 cm.
5. L'ARCHITECTURE CIVILE ET MILITAIRE
Si l'on excepte certains bâtiments intégrés à des ensembles d'architecture monastique non directement liés au culte – granges, écuries, hôtellerie, etc. –, il ne subsiste à peu près rien de l'architecture civile romane. Quelques habitations seigneuriales de la première moitié du xiie s., comme le palais épiscopal d'Auxerre (1116-1136), présentent une suite ininterrompue de baies en plein cintre, disposition typique de la plupart des demeures de l'époque et que l'on retrouve sur la façade romane de certaines maisons bourgeoises de Cluny et de Clermont-Ferrand. Bien que très restaurés, l'hôtel de ville de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne), celui de La Réole (Gironde) et, en Italie, le palazzo della Ragione de Vérone (1193) permettent de se faire une idée du style qui présidait à l'élaboration d'un grand édifice civil à la fin du xiie s. Deux ouvrages d'art, le pont Saint-Bénezet à Avignon (achevé en 1189) et le pont d'Airvault (Deux-Sèvres), sont pratiquement les seuls témoins des travaux communaux d'intérêt public construits en France avant le xiiie s.
En ce qui concerne l'urbanisme proprement dit, la vieille cité de Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales), derrière son enceinte fortifiée du xve s., compte parmi les très rares villes françaises qui laissent apparaître un tissu urbain d'époque romane, antérieur au xiiie s. Châteaux forts dotés d'un donjon de pierre (création romane dont le château de Langeais est en France l'un des premiers, vers 992-994, à être doté) et remparts constituent l'essentiel de l'architecture militaire de style roman, mais presque tous les remparts de ville médiévaux encore debout appartiennent à la période gothique. Construite à la fin du xie s., l'enceinte fortifiée d'Ávila, en Espagne, est une brillante exception et présente, avec ses 88 tours semi-circulaires et ses milliers de créneaux, le plus imposant monument de ce type.
6. LA SCULPTURE SUR PIERRE
Si les artistes carolingiens taillaient peu et mal la pierre, l'architecture romane est, souvent, le support d'une décoration sculptée riche, aux thèmes renouvelés.
6.1. DIVERSITÉ DES SUJETS
Dans les toutes premières réalisations romanes, vers la fin du xe s., la sculpture est avant tout décorative : palmettes, rinceaux, feuillages stylisés traités en à-plat se détachent peu du support. Le décor sculpté est en général cantonné dans quelques endroits : chapiteaux et tailloirs, portails. Les sculpteurs prennent de l'assurance à mesure que l'architecture progresse. Les motifs se creusent, les scènes à personnages sont de moins en moins maladroites, et plus nombreuses, plus vivantes. Les scènes d'inspiration religieuse dominent dans l'église, mais en dehors, sous les toitures, dans les cloîtres, aux baies des clochers, figurent des scènes profanes, parfois licencieuses. Certaines régions recèlent peu de sculpture à personnages. Les artistes normands, par exemple, excellaient dans le décor ornemental, mais n'ont laissé que de rares et maladroites scènes animées. Ailleurs, les sculpteurs font montre de maîtrise, laissant portraits sculptés, grandes scènes à personnages, jugements derniers, vies de saints, scènes de l'Ancien Testament : des chefs-d'œuvre par leur complexité et la qualité d'exécution.
6.2. UN ART EXPRESSIF
La sculpture romane frappe par la vie, la naïveté et le naturel. Il s'agit d'un art très expressif, ennemi de la raideur et de la standardisation. Le sculpteur possède une liberté de ton, se permet des associations de thèmes, crée impunément des animaux fantastiques, des végétaux imaginaires, donne une âme et une apparence, bonhomme ou grimaçante, aux personnages de la Bible, se représente lui-même. L'amour de Dieu, la vie quotidienne, l'humour, voire la raillerie, se mêlent intimement dans une démarche artistique, au sens moderne du terme. Cette sculpture illustre à merveille la façon dont est alors vécue la religion par la population: étroitement associée à la vie de tous les jours, dont l'église n'est que le reflet magnifié.
6.3. UN RÔLE DIDACTIQUE
Les scènes jouent, d'autre part, un rôle didactique important en montrant aux fidèles, qui ne savent pas lire, sous forme d'images simples mais parlantes, l'exemple de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il suffira, pour s'en convaincre, d'observer un instant la représentation de l'enfer et du paradis au tympan du Jugement dernier de l'église de Conques, dans l'Aveyron. La sérénité s'oppose à l'agitation, le sérieux au grotesque. La partie la plus originale est évidemment l'enfer, dans lequel le sculpteur a pris un malin plaisir à représenter les pécheurs entraînés dans la fournaise par des diables grimaçants.
6.4. LA SCULPTURE DU SECOND ART ROMAN
Dans le second art roman, la sculpture ornementale, moins spectaculaire, mais très présente, occupe en général des lieux plus discrets : bases de colonnes, tailloirs, corniches, encadrements de baies. Les thèmes sont variés : rinceaux, feuillages, grecques, entrelacs, motifs géométriques divers qui permettent d'occuper l'espace. On constate un recul des thèmes ornementaux, dits barbares, apportés en Occident par les peuples qui ont envahi l'Empire à partir du iiie s. Les thèmes francs, germains, wisigoths, normands, élaborés sur la base de figures animales stylisées et d'entrelacs, ont dominé l'ornementation pendant tout le haut Moyen Âge. Ils s'effacent à l'époque romane devant la représentation de la figure humaine et les motifs géométriques. Ils ne subsistent plus aujourd'hui que dans les pays à culture celtique. Ces motifs, dont l'évolution est rapide, sont des éléments de datation.
À partir de 1100, avec le cloître de Moissac, apparaissent les vastes programmes iconographiques. Ils vont se répandre partout : entre les chapiteaux des colonnades du sanctuaire, à Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand comme à Saint-Nectaire ; dans les fresques, du Liget ou de Tavant à Saint-Savin et à la Catalogne ; et sur les portails, largement sculptés. Encore que ces derniers se rencontrent en toutes régions, trois foyers, en France, atteignent à une perfection insurpassée : le Quercy, avec le développement du porche sud de Moissac ; la Bourgogne, où l'imagerie des scènes de détail est rachetée par la grandeur en comparaison immense du Christ central à Vézelay ou à Autun, chefs-d'œuvre qui ne doivent d'ailleurs pas nous faire oublier les tympans plus modestes mais non moins parfaits du Brionnais ; la Saintonge, enfin, préfère à la grande surface du tympan le large éventail des voussures superposées, le long desquelles court une sculpture dont la finesse n'exclut pas la puissance. Tous ces ensembles de chapiteaux, de fresques ou de portails composent une iconographie savante, moins étalée en scènes successives, à la manière réaliste, que jouant par correspondances entre thèmes répartis autour d'un axe central, suivant un esprit typiquement symboliste.
6.5. LES DIFFÉRENTES PIERRES
Depuis l'époque carolingienne, en raison de la rupture d'une part importante des anciennes routes commerciales, l'importation de marbre en Gaule s'est interrompue. Seule la Catalogne peut continuer à profiter des marbres pyrénéens, desquels les sculpteurs tirent des cloîtres historiés, des tables d'autel d'une grande beauté. Dans les autres régions, on continue parfois à remployer des marbres antiques, mais on taille le plus souvent la pierre locale, qui ne s'y prête pas toujours. C'est ainsi que les plus belles sculptures se rencontrent surtout dans des régions à pierre homogène et tendre, notamment des calcaires, faciles à tailler. Malheureusement, cette pierre est aussi la plus fragile et nous est souvent parvenue en piètre état. C'est le cas, par exemple, du tuffeau, pierre fine et tendre, remarquable par sa blancheur, travaillée en Anjou. À l'inverse, les grès ou les schistes se taillent difficilement mais sont très résistants. La Bretagne conserve pour cette raison une sculpture médiévale dont la maladresse est imposée par la faible plasticité du support. Il faut attendre la fin de la période romane, et l'avènement du gothique, vers la fin du xiie s., pour que des conditions économiques plus favorables permettent le transport à longue distance des meilleurs calcaires, dont la nouvelle architecture rend l'emploi indispensable.
7. LES ARTS DE LA COULEUR ET LES ARTS DÉCORATIFS
Si les édifices apparaissent aujourd'hui avec des parois nues, à l'époque romane, la couleur envahit les églises. Toute la surface disponible est peinte ou couverte de mosaïque. Celle-ci, constituée de galets, de marbre polychrome ou de carrelage, recouvre également le sol des sanctuaires importants, dont les fenêtres sont ornées de vitraux. Même les sculptures sont peintes de couleurs vives, afin de produire l'impression la plus forte sur les fidèles.
7.1. LA PEINTURE MURALE
Les couleurs employées sont essentiellement l'ocre jaune ou rouge, le vert, le blanc et le noir. Elles sont utilisées pour renforcer les lignes de l'architecture et de la sculpture, et pour couvrir les murs de scènes historiées souvent organisées par registres horizontaux.
À l'inverse de l'architecture et de la sculpture, qui rompent avec les traditions antérieures, la peinture murale paraît s'inscrire dans la continuité de la peinture du haut Moyen Âge, tant du point de vue des techniques que de l'iconographie. On privilégie les scènes bibliques et les figures de saints, accompagnées d'inscriptions également peintes. La peinture ornementale couvre tous les espaces que les scènes historiées sculptées ou peintes n'occupent pas, notamment par des décors peints de faux appareil, fait de joints dessinés à l'ocre rouge sur un crépi cachant une maçonnerie parfois peu soignée. L'abandon progressif de la mosaïque, très chère, laisse la part belle à la peinture murale, moins coûteuse, plus simple, et correspondant probablement mieux au goût de l'époque. La peinture couvre une surface importante à l'intérieur des édifices, mais elle s'étend aussi fréquemment à l'extérieur.
En comparaison des milliers de cycles peints, semble-t-il durant la période romane, ceux qui ont été conservés sont bien rares. Les nombreuses transformations architecturales effectuées depuis le Moyen Âge, les changements de décor, les restaurations trop lourdes depuis le xixe s. en ont fait disparaître une grande part. Les exemples visibles, à Berzé-la-Ville, à Saint-Savin-sur-Gartempe, à Tavant, notamment, sont des témoignages lacunaires d'un art désormais difficile à comprendre.
Sans atteindre l'habileté des artistes antiques, les peintres romans travaillent plus volontiers la peinture sur enduit frais, c'est-à-dire la fresque, plutôt que celle sur enduit sec. Les pigments appliqués sur un enduit encore humide y pénètrent profondément, rendant les couleurs presque inaltérables. La difficulté de cette technique – la scène doit être achevée avant le séchage de l'enduit, soit en quelques heures à peine – oblige souvent les artistes à compléter à sec certaines parties des scènes : traits du visage, détails de vêtement, dont la conservation est moins bonne.
7.2. L'ENLUMINURE
Peu de fresques romanes ayant été correctement conservées, les manuscrits enluminés sont un précieux témoin de la peinture de cette époque. Tandis que les sculpteurs romans couvrent les portails du thème du Jugement dernier, les enlumineurs constituent à travers l'illustration des beatus une impressionnante imagerie de l'Apocalypse. C'est ainsi que le Commentaire sur l'Apocalypse (vers 776) de Beato de Liébana, maintes fois recopié et enluminé par les moines du León et de Castille au xe s., est orné entre 1028 et 1072, à l'abbaye de Saint-Sever-sur-l'Adour, d'enluminures où peut s'observer le passage du style préroman ibérique au style roman. On peut y voir, représentés avec une saisissante précision, des criquets ailés mandés par Satan pour tourmenter le genre humain de leurs queues de scorpion.
Au puissant expressionnisme de telles scènes répond l'élégance des lettrines dont abondent les manuscrits. Tout comme les chapiteaux des églises, elles s'ornent souvent de visages humains, d'animaux familiers, sauvages ou fabuleux. Parfois ces motifs constituent l'initiale elle-même, dont ils prennent la forme, comme c'est le cas dans la copie des Moralia de saint Grégoire le Grand, exécutée à Cîteaux en 1111.
7.3. LES ARTS SOMPTUAIRES
Leur épanouissement est considérablement favorisé par la prospérité des monastères. L'orfèvrerie (statue en or, cristal de roche et pierres précieuses du trésor de l'église Sainte-Foy, à Conques, dans l'Aveyron, du xe s.), le travail de l'ivoire et du bois, du bronze et du cuivre (buste-reliquaire de saint Baudime de l'église de Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme, fin du xiie s.), celui de l'émail champlevé, que pratiquent les artistes du Limousin (châsse d'Ambazac, xiie s. ; reliquaire de Germigny-des-Prés, xiiie s.) comme ceux des écoles rhénanes de Trèves ou de Hildesheim, l'art textile (broderie dite « tapisserie de la reine Mathilde », ou « de Bayeux », fin du xie-début du xiie s. ; « tapisserie de la Création » de la cathédrale de Gérone, du même type, vers 1100) expriment la diversité et la puissance décorative de l'art roman.
7.4. LES VITRAUX
Les fragments de vitraux romans conservés sont rares mais éloquents. Bien que la lumière n'ait pas à cette époque l'importance que lui accordera l'art gothique – les arcs-boutants permettront d'alléger les murs, qui s'ouvriront de larges baies –, les vitraux qui la colorent sont particulièrement appréciés. Des témoins en sont conservés dans les pays germaniques et dans l'ouest de la France, notamment une Ascension à la cathédrale du Mans, dont le style est proche de la peinture ou de la miniature contemporaines, et des verrières de la cathédrale de Poitiers. À Chartres, le vitrail de Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière a été sauvé de l'incendie qui ravagea la cathédrale en 1194. Il est donc antérieur à la fin du xiie s. Enchâssé de nouveau dans une baie de l'église gothique, il constitue l'un des meilleurs témoignages de l'art du vitrail de l'époque romane tardive, tout en annonçant, par ses bleus et ses rouges profonds, le type de Chartres.
7.5. LES SOLS
La plupart des églises doivent se contenter d'un sol de terre battue, ou dallé en pierre. Certaines bénéficient d'un sol orné d'une mosaïque de pierres polychromes, comme l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire et, à Florence, San Miniato al Monte, ou d'un véritable carrelage en terre cuite. Il s'agit alors soit de carreaux carrés monochromes organisés en damier, soit de carreaux de formes géométriques diverses qui, associés, permettent de créer des motifs très variés.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Franklin Delano Roosevelt |
|
|
| |
|
| |
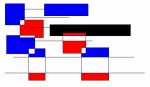
Franklin Delano Roosevelt
Cet article fait partie du dossier consacré à la Seconde Guerre mondiale.
1. L'ASCENSION VERS LA PRÉSIDENCE
1.1. ORIGINES ET FORMATION
De son père, James Roosevelt (1828-1900), gentilhomme campagnard administrateur de plusieurs sociétés, le jeune Franklin reçoit le nom ; de sa mère, Sarah Ann Delano (1854-1941), issue d'une famille riche possédant des mines et une flotte de navires, il hérite la fortune. Appartenant à l'élite, il bénficie du meilleur enseignement de l'époque : à Groton, puis à Harvard, enfin à Columbia, où il acquiert son diplôme d'avocat. Ce n'est pas un élève brillant, mais il sait se faire apprécier de ses camarades. Ses activités sont moins intellectuelles que sociales ; ses goûts le portent vers les bateaux et les chevaux, beaucoup plus que vers la jurisprudence.
1.2. LA CONQUÊTE DU SIÈGE DE SÉNATEUR DE L'ÉTAT DE NEW YORK
En 1905, il épouse une lointaine cousine, Anna Eleanor (1884-1962), qui est la nièce du président républicain Theodore Roosevelt. Pendant quelque temps, le jeune Franklin travaille dans un cabinet d'affaires de New York. Puis, en 1910, le parti démocrate lui demande de se présenter aux élections sénatoriales de l'État de New York : son nom, sa fortune, son dynamisme devraient faire merveille dans une région qui traditionnellement vote républicain. Au terme d'une campagne menée en automobile, il est élu.
1.3. SECRÉTAIRE ADJOINT À LA MARINE (1913-1921)
Son inclination le pousse du côté des progressistes, et, lorsque Thomas Woodrow Wilson se présente à l'élection présidentielle de 1912, F. D. Roosevelt ne lui marchande ni son aide ni son appui. Il en est récompensé : le nouveau président fait de lui son secrétaire adjoint à la Marine (1913) ; c'est un poste où le brillant jeune homme peut unir son goût de la politique à sa passion pour les bateaux. Il exerce ses fonctions jusqu'en 1921 ; c'est dire qu'il a l'occasion de vivre, à un niveau élevé, des événements de grande importance : les multiples interventions militaires de son pays aux Antilles, la préparation et la participation à la Grande Guerre, les vains efforts de Wilson pour faire ratifier le traité de paix (→ traité de Versailles) et le pacte de la Société des Nations (SDN).
F. D. Roosevelt est un fidèle partisan de son président, le défenseur inébranlable d'une puissante marine non dépourvu d'idées originales (il recommande avec vigueur en 1917 de lutter contre les sous-marins allemands par une attaque de leurs bases), mais sa jeunesse, ses airs de dandy ne lui confèrent qu'une audience limitée. Quoi qu'il en soit, la convention du parti en 1920 le désigne comme candidat à la vice-présidence ; les démocrates n'ont aucune chance de gagner les élections, mais F. D. Roosevelt se fait mieux connaître dans le pays.
1.4. LE CHOIX DÉLIBÉRÉ DE LA POLITIQUE
L'arrivée des républicains au pouvoir le ramène à la vie privée. Au cours de l'été de 1921, il est frappé par la poliomyélite et lutte contre la maladie pendant plusieurs semaines. Il recouvre partiellement l'usage de ses jambes. Sa vie politique est gravement compromise ; il pourrait même y renoncer ; sa fortune, l'exemple de son père, les encouragements de sa mère l'incitent à mener la vie tranquille du gentilhomme campagnard.
Mais, sous l'influence d'Eleanor, il réagit différemment : son caractère devient plus ferme ; il prend le goût de l'effort ; ses lectures se font plus nombreuses ; la vie politique est un excellent dérivatif à son infirmité. À demi paralysé, il manifeste une indomptable énergie, un allant qui surprend son entourage et bientôt le pays, une gaieté et une santé morale à toute épreuve. Paradoxalement, il incarne l'optimisme.
1.5. GOUVERNEUR PROGRESSISTE DE L'ÉTAT DE NEW YORK (1929-1932)
Dès 1924, F. D. Roosevelt reparaît dans les assemblées du parti. En 1928, il brigue le poste de gouverneur de l'État de New York auquel il est (il sera réélu en 1930). C'est à ce poste que F. D. Roosevelt fait l'expérience des effets de la crise : comme le plus grand nombre de ses concitoyens, il a été surpris par l'ampleur du marasme. Mais, avec l'aide de Frances Perkins (1882-1965) et de Harry Lloyd Hopkins (1890-1946) – qui joueront un rôle primordial de 1933 à 1945 –, il met au point les premières mesures de secours, notamment la Temporary Emergency Relief Administration, qui dispose d'un budget de 60 millions et vient en aide à un million de chômeurs.
Ses fonctions politiques, sa volonté de combattre la crise ont accru son influence. En 1932, le parti démocrate – qui a surmonté ses divisions – a le vent en poupe : or le président Herbert C. Hoover a déçu et ne parvient pas à redonner confiance.
1.6. CANDIDAT CHARISMATIQUE À LA PRÉSIDENCE DES ÉTATS-UNIS
La convention démocrate, réunie à Chicago en juillet 1932, désigne F. D. Roosevelt comme le candidat du parti à la présidence. Contrairement aux usages, F. D. Roosevelt se rend en avion devant les délégués pour accepter leur investiture. Sa campagne, il la mène tambour battant. Lui, l'infirme, il ne cesse de se déplacer d'un État à l'autre et, par son sourire, sa cordialité, son goût de la vie, remonte le moral de ses concitoyens.
Pour lutter contre la crise, il annonce le New Deal, une « Nouvelle Donne » qui ne comporte aucun programme précis. Ce qu'affirme Roosevelt, c'est que le temps de l'individualisme est passé : « L'heure est venue de faire appel à un gouvernement éclairé. » Les obscurités n'en demeurent pas moins : le gouvernement fédéral devra-t-il dépenser ou économiser ? Contrôlera-t-il la vie économique, et jusqu'à quel point ? Faut-il maintenir une monnaie solide ou donner libre cours aux tendances inflationnistes ? Qui, des États ou de l'Union, viendra au secours des chômeurs ? L'équivoque n'épargne pas davantage le programme de politique extérieure : F. D. Roosevelt a pris parti, sous la pression de son aile droite, contre l'entrée des États-Unis dans la SDN.
Mais il sait se faire entendre des Américains ; il a le génie des formules ; il exprime de grandes idées avec des phrases simples ; il « sent » ce que la majorité attend de lui. Aussi, le 8 novembre 1932, son succès électoral est-il net : il obtient près de 23 millions de voix et 472 mandats électoraux, contre 15 millions de voix et 59 mandats pour Hoover ; le candidat socialiste arrive en troisième position avec 900 000 suffrages.
2. LE PRÉSIDENT F. D. ROOSEVELT (1933-1941)
2.1. LE VÉRITABLE FONDATEUR DE LA PRÉSIDENCE MODERNE
AU CENTRE DE GRAVITÉ DE TOUTE LA VIE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Le président devient le centre de gravité de toute le vie politique économique et sociale. Il conduit l'opinion publique, sans jamais perdre contact avec elle ; il la stimule, mais se garde d'aller trop vite. Il informe simplement et honnêtement : les « causeries au coin du feu » donnent pour la première fois dans l'histoire un rôle primordial à la radio.
Avec la presse, Roosevelt éprouve plus de difficultés : bien qu'en 1936, les deux tiers des journaux lui soient hostiles, il tient de fréquentes conférences de presse, au cours desquelles il charme, flatte, annonce ou menace. D'ailleurs, F. D. Roosevelt a le sens du « drame » : ce qui compte pour lui, c'est d'occuper par ses paroles et ses déplacements la première page ; il ne s'en prive pas.
Entre son élection et son entrée en fonction, il a mis sur pied son équipe, qu'il conservera pendant la quasi-totalité de l'administration Roosevelt, jusqu'en 1945 : le sénateur du Tenessee, Cordell Hull, au secrétariat d'État (Affaires étrangères), Henry Morgenthau au Trésor, Henry Wallace à l'Agriculture, Harold L. Ickes à l'Intérieur.
Contrairement à ses prédécesseurs, il fait appel à des intellectuels et s'entoure de son brain-trust, une structure parallèle rassemblant des hommes de confiance, des spécialistes dont il attend les recommandations. Désormais, c'est vers Washington que se tournent les regards des intellectuels américains.
UN EXÉCUTIF ÉLARGI, PRENANT L'INITIATIVE DES LOIS ET N'HÉSITANT PAS À RECOURIR AU VETO
De 1933 à 1945, le pouvoir exécutif ne cesse d'étendre ses compétences. Agences et bureaux sont chargés de mettre en œuvre les mesures législatives qui ont été adoptées par le Congrès ; ils touchent à tous les domaines et travaillent en relation étroite avec la Maison-Blanche. Toutefois, le Congrès subit un effacement limité : si F. D. Roosevelt est assez populaire pour faire élire dans son sillage des sénateurs et des représentants, il ne parvient pas, notamment en 1938, à empêcher la réélection de ceux qui lui déplaisent. En revanche, c'est de plus en plus de la présidence que partent les projets de lois ; F. D. Roosevelt vient en personne les soutenir devant le Congrès, prodigue ses encouragements aux législateurs frileux et n'hésite pas à recourir fréquemment au veto lorsque les « bills » du Congrès lui déplaisent.
Le président Roosevelt sait adapter la Constitution de 1787 aux besoins de la société des années 1930. « Notre Constitution, disait-il en mars 1933, est si simple et si pratique qu'il est toujours possible de faire face à des nécessités exceptionnelles par de simples changements d'accent et d'organisation sans rien perdre des formes essentielles. » Dans cette perspective, le gouvernement fédéral propose des objectifs nationaux, mais les États lui sont associés dans le choix des solutions et l'application des mesures décidées.
LE PRAGMATISME EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE
Pour relever l'économie du pays, pour assurer la mobilisation des énergies nationales pendant le conflit mondial, deux principes guident l'action de Roosevelt. Le premier est qu'il faut moderniser le capitalisme américain, et non le détruire : Roosevelt n'a nullement souhaité le bouleversement de la société. En second lieu, F. D. Roosevelt est essentiellement un pragmatique : les doctrines économiques, il n'y croit guère ; il les expérimente : si l'une ne donne pas les résultats escomptés, il recourt à l'autre – ou bien il utilise les deux en même temps.
Son administration a été, l'espace de quelques années, le champ de bataille entre les libéraux et les partisans de la planification, entre les défenseurs de l'équilibre budgétaire et les tenants des dépenses fédérales, qui ne peuvent que mettre le budget en position de déficit.
LES PREMIÈRES MESURES D'URGENCE
Les États-Unis de mars 1933 sont au plus bas : 13 millions de chômeurs, les banques fermées, l'agriculture en pleine crise ; le produit national brut est passé de 104,4 milliards en 1929 à 60 milliards. La tâche du nouveau président est colossale. Il commence par redonner confiance : « La seule chose que nous ayons à craindre, déclare-t-il dans son discours inaugural, c'est la crainte elle-même, cette terreur sans nom et sans fondements, sans justification, qui paralyse les efforts nécessaires pour transformer une retraite en progression. »
Roosevelt lutte contre la crise en améliorant le pouvoir d'achat des classes défavorisées : agriculteurs et ouvriers. Pour cela il impose le contrôle fédéral aux banques et aux industries, et s'appuie sur l'opinion publique à laquelle il s'adresse dans ses « causeries au coin du feu ». Il réalise la réforme bancaire (fermeture des banques pour quatre jours, Emergency Banking Bill) et supprime la prohibition (mars 1933), abandonne l'étalon-or (avril 1933), dévalue le dollar (Gold Reserve Act, 1934) et favorise l'expansion du crédit. Il établit l'AAA (Agricultural Adjustment Act, 12 mai 1933) pour diminuer les excédents agricoles et alléger les dettes des fermiers.
Enfin, il cherche à faire reculer le chômage grâce à une politique de grands travaux (lutte contre l'érosion, reboisement, grands barrages, mise en valeur de la vallée du Tennessee), aux codes de la NRA (National Recovery Administration, juin 1933), chargée de réglementer les conditions du travail ; grâce aussi aux dispositions du National Labor Relations Act de 1935 (protection des syndicats), du Social Security Act (1935) et du Fair Labor Standards Act de 1938 (fixation de salaires minimaux et de durées maximales de travail). Hostile à l'esprit interventionniste du New Deal, la Cour suprême en rejette les deux textes essentiels : la NRA (1935) et l'AAA (1936).
Roosevelt, ayant été réélu triomphalement (novembre 1936), use de son prestige pour tenter, mais en vain, d'obtenir du Sénat la réorganisation de la Cour suprême ; pourtant, celle-ci, inquiète, valide de nombreuses décisions libérales en matière sociale, tandis que le président fait voter le Wagner Housing Act encourageant la construction (septembre 1937). L'ensemble de ces mesures renforce le pouvoir fédéral, renouvelle les cadres de la vie politique et entraîne la mutation du parti démocrate en un parti progressiste.
Pour en savoir plus, voir l'article New Deal.
UN PRÉSIDENT CONTESTÉ
F. D. Roosevelt n'a pas manqué d'ennemis. L'opposition vient autant des milieux économiques que politiques. Que ce soit les républicains, qui défendent alors les intérêts des conservateurs et , se plaignent de la brutalité dans l'application des réformes, des fascistes de tous horizons (les Silver Shirts, à l'imitation des Chemises noires de Mussolini), la Cour suprême jusqu'en 1937 ou la minorité de l'extrême gauche, tous ont souligné l'incohérence de sa politique, tous ont rappelé qu'en 1939 les États-Unis comptaient encore 9 500 000 chômeurs, que le produit national brut n'avait pas, en prix courants et malgré la dévaluation de 1934, retrouvé le niveau de 1929.
C'est la production de guerre qui tirera les États-Unis du gouffre où la crise les avait plongés. Mais F. D. Roosevelt a fourni à son pays les moyens politiques et économiques, la confiance nécessaire pour affronter le conflit mondial et en tirer les plus grands profits. L'opinion le suit puisqu'il est triomphalement réélu en 1936.
2.2. LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
S'ASSURER UN BON VOISINAGE
Par une politique extérieure de bon voisinage, Roosevelt groupe finalement les républiques de l'Amérique latine autour des États-Unis. Il fait même évacuer le Nicaragua (1933), Haïti (1934), assure l'émancipation politique de Cuba (1934) et de Panamá (1936), promet l'indépendance aux Philippines pour 1944. Ayant reconnu l'Union soviétique dès 1933, il garde une certaine réserve à son égard, mais s'inquiète surtout des régimes de Hitler et de Mussolini.
ROMPRE L'ISOLATIONISME
Longtemps, en effet, l'opinion américaine s'est désintéressée des événements d'Europe – un peu moins de la situation en Extrême-Orient. Bien plus, elle a approuvé les précautions qui ont été prises de 1935 à 1937 pour éviter que le pays ne soit entraîné dans une nouvelle guerre. L'isolationnisme est alors triomphant. Roosevelt lui-même ne peut que se plier à la volonté de ses concitoyens.
Mais, dès 1937, il manifeste son inquiétude : son discours d'octobre recommande de mettre en quarantaine les agresseurs ; la marine reçoit du renfort, l'armée ne compte en 1939 que 200 000 hommes. Le président suggère une conférence mondiale sur la limitation des armements ; sa voix n'est pas entendue ; il ne dispose pas des forces suffisantes pour empêcher l'Allemagne de déclencher la guerre.
Persuadé que les États-Unis ne pourront rester à l'écart d'une guerre européenne, Roosevelt fait voter la loi de neutralité le 5 septembre 1939 (révisée le 21 septembre), abrogeant les clauses de l'embargo et autorisant la vente d'armement aux belligérants qui peuvent le payer comptant et l'emporter (Cash and Carry).
Après la défaite de la France (juin 1940), il obtient des crédits pour le réarmement, l'établissement de la conscription (septembre 1940) et cède cinquante destroyers à la Grande-Bretagne. Ayant, contre toutes les traditions, demandé et obtenu un troisième mandat présidentiel (novembre 1940), il accentue sa politique d'aide aux démocraties. En mars 1941, le Congrès adopte la loi du prêt-bail (Lend-Lease Act) – une idée de Roosevelt – qui permet aux États-Unis de fournir gratuitement de l'aide aux Britanniques, puis aux Soviétiques, aux Chinois, aux Français libres. Un programme de mobilisation économique est mis sur pied. En août 1941, Roosevelt rencontre Churchill, et les deux hommes énumèrent les buts de guerre de leur pays dans la charte de l'Atlantique qui pose comme base à la reconstruction du monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la liberté des hommes et des biens de transiter d'un pays à un autre.
LE CHEF DE GUERRE
Lorsque les Japonais attaquent la base de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les Américains sont prêts, grâce à leur président, à s'engager activement dans la guerre. La déclaration de guerre à l'Allemagne (11 décembre), accroît les responsabilités de Roosevelt : il doit diriger l'effort de guerre des États-Unis, équiper leurs alliés, décider la fabrication de la bombe atomique et préparer l'après-guerre.
Appliquant sa méthode des contacts personnels pour résoudre les problèmes militaires et diplomatiques de la coalition, il rencontre plusieurs fois Churchill, à Washington (décembre 1941), à Casablanca (→ conférence de Casablanca, janvier 1943), à Washington (mai 1943), à Québec (→ conférences de Québec, août 1943), et avec lui rencontre Tchang Kaï-chek (Le Caire, novembre 1943), Staline (→ conférence de Téhéran, nov.-déc. 1943 ; conférence de Yalta, février 1945).
Désireux d'éviter toute rupture avec l'URSS, Roosevelt consent à un déplacement de la Pologne vers l'ouest et s'oppose avec Staline au projet anglais de débarquer dans les Balkans, en cédant d'avance le contrôle de cette région à l'URSS (conférence de Téhéran, 1943), à laquelle il abandonne en outre Port-Arthur, les chemins de fer transmandchourien et sudmandchourien, le sud de Sakhaline et les îles Kouriles, en échange d'une promesse d'intervention militaire contre le Japon après la capitulation de l'Allemagne (Yalta, 1945).
Ayant posé le principe d'élections libres et de frontières conformes à la volonté des populations, le président des États-Unis renonce à placer les colonies sous une tutelle internationale. Préoccupé de mettre au point la meilleure formule de sécurité collective, il accepte, en 1943, l'idée d'une Organisation des Nations unies (ONU), dont il fait élaborer le plan (→ plan de Dumbarton Oaks, 1944) et qu'il convoque pour une première session à San Francisco (1945). Il se fait réélire pour un quatrième mandat en novembre 1944, mais il meurt (12 avril 1945) à la veille de la victoire.
Roosevelt laisse à son pays un atout considérable : la plus grande puissance économique de la planète, et une mission redoutable : assurer la défense de la démocratie dans un monde où s'annonce déjà la guerre froide.
Pour en savoir plus, voir les articles Histoire des États-Unis, Seconde Guerre mondiale.
PLAN
*
* 1. L'ASCENSION VERS LA PRÉSIDENCE
* 1.1. Origines et formation
* 1.2. La conquête du siège de sénateur de l'État de New York
* 1.3. Secrétaire adjoint à la Marine (1913-1921)
* 1.4. Le choix délibéré de la politique
* 1.5. Gouverneur progressiste de l'État de New York (1929-1932)
* 1.6. Candidat charismatique à la présidence des États-Unis
* 2. LE PRÉSIDENT F. D. ROOSEVELT (1933-1941)
* 2.1. Le véritable fondateur de la présidence moderne
* Au centre de gravité de toute la vie politique économique et sociale
* Un exécutif élargi, prenant l'initiative des lois et n'hésitant pas à recourir au veto
* Le pragmatisme en matière économique
* Les premières mesures d'urgence
* Un président contesté
* 2.2. La politique extérieure
* S'assurer un bon voisinage
* Rompre l'isolationisme
* Le chef de guerre
Médias associés

Discours du président Roosevelt lors de sa visite à Harrisburg (Pennsylvanie), octobre 1936

F. D. Roosevelt en campagne électorale (1932)

Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt, déclaration de guerre contre le Japon
Articles associés
Churchill.
sir Winston Leonard Spencer Churchill. Homme d'État britannique...
Cour suprême des États-Unis.
Juridiction fédérale américaine la plus élevée, dont le rôle est...
démocrate (parti).
Le plus ancien des deux grands partis qui dominent la...
États-Unis.
État fédéral d'Amérique du Nord, incluant l'Alaska (au nord-ouest du Canada) et les îles Hawaii (dans le Pacifique nord)...
Gaulle.
Charles de Gaulle. Homme d'État français...
Hirohito.
Empereur du Japon...
Hitler.
Adolf Hitler. Homme d'État allemand...
Hoover.
Herbert Clark Hoover. Homme d'État américain...
Johnson.
Lyndon Baines Johnson. Homme d'État américain...
Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy. Homme d'État américain...
Voir plus
Chronologie
* 1933 F. D. Roosevelt, président des États-Unis, engage la politique du New Deal.
* 1935 Loi Wagner aux États-Unis (juillet).
* 1936 Réélection de F. D. Roosevelt.
* 1937-1938 Nouvelle crise économique aux États-Unis.
* 1939 Cash and Carry Act, modifiant la loi de neutralité américaine en faveur des Alliés (4 novembre).
* 1942 Lancement du « Victory Program » aux États-Unis (6 janvier).
* 1943 Conférence de Téhéran ; W. Churchill, F. D. Roosevelt et J. Staline décident du débarquement des Alliés en Provence (28 novembre).
* 1944 Conférence de Bretton Woods (juillet).
* 1945 Conférence de Yalta entre J. Staline, W. Churchill et F. D. Roosevelt (4-11 février).
* 1945 Mort de F. D. Roosevelt, remplacé par H. S. Truman (12 avril).
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
