|
| |
|
|
 |
|
Diabète de type 2 : comprendre la régulation du taux de sucre pour mieux le traiter |
|
|
| |
|
| |
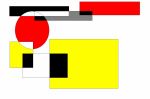
Diabète de type 2 : comprendre la régulation du taux de sucre pour mieux le traiter
COMMUNIQUÉ | 20 AVRIL 2015 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Les individus diabétiques de type 2, résistant à l’insuline, souffrent d’un taux de glucose trop élevé dans le sang qu’ils tentent de diminuer aujourd’hui grâce à une nouvelle classe d’antidiabétiques, les “gliflozines”. Ces nouvelles molécules abaissent le taux de sucre mais produisent également un effet paradoxal en entrainant la sécrétion de glucagon, source supplémentaire de glucose. Les unités mixtes de recherche 1190 « Recherche translationnelle sur le diabète » (Université de Lille, Inserm, CHRU Lille), dirigée par François Pattou, et 1011 « Récepteurs nucléaires, maladies cardiovasculaires et diabète » dirigée par Bart Staels[1], décrivent un nouveau mécanisme de régulation de la sécrétion du glucagon chez l’homme permettant d’élucider ce phénomène et suggère une adaptation de ce nouveau type de traitements.
Ces résultats obtenus à Lille au sein du Labex Egid (European Genomic Institute for Diabetes) sont publiés dans la revue Nature Medicine le 20 avril 2015.
L’équipe dirigée par François Pattou développe des thérapies innovantes pour lutter contre les formes les plus sévères du diabète, une maladie caractérisée par un taux élevé de sucre dans le sang : l’hyperglycémie chronique. Pour le traitement du diabète de type 1, les projets du laboratoire s’appuient sur la production d’îlots humains qui sont greffés chez les patients. La greffe d’îlots restaure la production d’insuline, l’hormone qui régule le taux de sucre en le stockant lorsqu’il est trop élevé dans le sang. L’analyse des îlots humains destinés à la greffe permet l’évaluation des cellules pour améliorer leur greffe. Dans ce contexte l’équipe, en collaboration avec l’équipe de Bart Staels, spécialisée dans le développement de nouvelles molécules, a découvert un nouveau mécanisme de régulation de la sécrétion du glucagon chez l’homme qui explique un effet secondaire d’une nouvelle classe d’antidiabétiques Cette dernière est utilisée pour traiter le diabète de type 2 observé en cas d’obésité et caractérisé par une résistance à l’insuline.
Lorsque les cellules détectent un niveau bas de sucre (ex: au cours du jeune), une augmentation de la quantité de glucose dans le sang est nécessaire afin d’assurer l’énergie dont le corps a besoin. C’est là qu’intervient une autre hormone, le glucagon, dont le rôle est de stimuler la production de sucre par le foie afin de rétablir au plus vite un taux normal de glucose dans le sang. Cette hormone, sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langherans du pancréas, est un peu oubliée par rapport à l’Insuline, produite par les cellules béta pour stimuler le stockage du sucre. Elle est pourtant essentielle dans la physiopathologie du diabète.
Dans cette étude, les chercheurs ont découvert qu’un cotransporteur du glucose (SGLT2) que l’on connait pour réabsorber le glucose dans le rein, est présent dans les cellules alpha et contrôle la sécrétion de glucagon. En mesurant l’expression génique de ce transporteur dans des îlots de donneurs diabétiques (type 2), ils ont observé une diminution de l’expression de SGLT2 et une augmentation de l’expression du glucagon par rapport aux îlots de sujets sains. Ce résultat est confirmé chez la souris diabétique de type 2 lorsqu’elle devient de plus en plus obèse, l’expression du cotransporteur diminue.
De manière inattendue, en révélant ce mécanisme, les chercheurs expliquent l’augmentation paradoxale du taux de glucagon observée chez les patients ayant recours à une nouvelle classe d’antidiabétiques “Gliflozines“, commercialisée aux Etats Unis et au Royaume Uni. Cette classe médicamenteuse cible le transporteur du glucose situé dans le rein, empêchant la réabsorption du glucose élevé chez les diabétiques et son élimination en partie dans les urines.
“Le traitement antidiabétique, “Dapagliflozin”, en bloquant le récepteur SGLT2, stimule les cellules alpha et augmente la sécrétion de glucagon” explique François Pattou.
Cet effet inattendu pourrait limiter au moins en partie l’effet hypoglycémiant de ce traitement antidiabétique, et justifie pour les chercheurs l’administration simultanée d’autres molécules limitant la sécrétion de glucagon comme les sulfonylurés ou les analogues du GLP-1. Avant sa commercialisation en France qui est envisagé dans les prochains mois, cette découverte pourrait permettre aux patients souffrant d’un diabète de type 2 bénéficiant de traitement, d’optimiser son efficacité.
L’Institut européen de génomique sur le diabète – Egid
La mission principale de la Fédération de recherche Egid (Université de Lille / CNRS / Inserm / CHRU Lille / Institut Pasteur de Lille), Institut européen de génomique sur le diabète, qui a obtenu un Labex dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, est d’identifier les facteurs de risque du diabète et de mieux comprendre les mécanismes d’apparition de ses complications afin de prévenir la survenue de cette maladie invalidante et de mieux traiter les patients. Cette fédération de recherche Egid est constituée de trois équipes fondatrices: l’UMR 1011 «Récepteurs nucléaires, maladies cardiovasculaires et athérosclérose» dirigée par le Pr Bart Staels (Université de Lille, Institut Pasteur de Lille, Inserm) , l’UMR 1190 « recherche translationnelle sur le diabète » dirigée par le Pr François Pattou (Université de Lille, Inserm,CHRU Lille,), et l’UMR 8199 « Génomique Intégrative et modélisation des maladies métaboliques » dirigée par le Pr Philippe Froguel (Université de Lille, CNRS, Institut Pasteur de Lille).
[1]Université de Lille, Inserm, CHRU Lille, Institut Pasteur de Lille
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Phagothérapie : la nécessaire coopération entre bactériophage et système immunitaire |
|
|
| |
|
| |

Phagothérapie : la nécessaire coopération entre bactériophage et système immunitaire
COMMUNIQUÉ | 12 JUIL. 2017 - 17H19 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Deux équipes de l’Institut Pasteur, en collaboration avec des chercheurs de l’Inserm et du Georgia Institute of Technology aux Etats-Unis, viennent de démontrer que, pour garantir la bonne efficacité d’une phagothérapie lors d’une infection bactérienne in vivo, l’action des bactériophages doit s’appuyer sur celle du système immunitaire de l’hôte. Cette synergie repose notamment sur l’action clé des cellules immunitaires neutrophiles. Cette découverte permet de mieux comprendre l’action thérapeutique des bactériophages dans le traitement de certaines infections bactériennes. Ces travaux sont publiés dans la revue Cell Host and Microbe le 12 Juillet 2017.
La phagothérapie repose sur l’utilisation de bactériophages (ou « phages ») pour traiter les infections bactériennes. Les phages sont des virus s’attaquant spécifiquement aux bactéries ; ils sont inoffensifs pour l’homme. Le recours à cette stratégie thérapeutique, conceptualisée il y a 100 ans, a connu un net recul dans le monde occidental, suite au développement des antibiotiques. Cependant, alors que le nombre d’infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques augmente de façon alarmante, la phagothérapie connait actuellement un regain d’intérêt, notamment en Europe.
Jusqu’à présent, les données scientifiques n’étaient pas suffisantes pour comprendre le fonctionnement de la phagothérapie in vivo. En effet, la plupart des études menées in vitro avaient déjà prouvé que les phages tuent les bactéries qu’ils ciblent spécifiquement, mais aucune de ces études n’avait pu prendre en compte l’importance de la réaction de l’hôte face à cette activité.
Deux équipes de l’Institut Pasteur – le groupe Interactions bactériophages/bactéries chez l’animal de Laurent Debarbieux et l’unité Immunité innée dirigée par James Di Santo (Inserm U1223) -, en collaboration avec l’équipe de Joshua Weitz au Georgia Institute of Technology (Atlanta, Etats-Unis), viennent de démontrer l’importance du statut immunitaire du patient dans les chances de réussite d’une phagothérapie. Pour ce faire, ils ont mené une double approche originale en combinant un modèle animal et une modélisation mathématique.
Afin d’évaluer l’efficacité d’un traitement par une seule espèce de phages, les chercheurs se sont penchés sur la bactérie Pseudomonas aeruginosa qui est impliquée dans des infections respiratoires comme les pneumonies. Cette bactérie, résistante aux carbapénèmes, les « antibiotiques de la dernière chance », a été classée par l’OMS parmi les quatre plus menaçantes au niveau mondial pour des phénomènes de résistance aux antibiotiques.
Les chercheurs ont ainsi pu montrer que, chez les animaux avec un système immunitaire sain (dits « immunocompétents »), le traitement par phagothérapie est efficace. Le système immunitaire inné, rapidement mobilisable, et les phages agissent, dans un premier temps, en parallèle pour lutter contre l’infection. Puis, au bout de 24 à 48 heures, certaines bactéries deviennent naturellement résistantes aux phages qui ne peuvent plus assurer leur rôle. Le système immunitaire inné prend alors en charge la destruction de ces bactéries. Parmi les cellules immunitaires impliquées, les polynucléaires neutrophiles (des globules blancs provenant de la moelle osseuse) tiennent une place prépondérante.
Parallèlement, les simulations in silico ont permis de démontrer que la réponse innée doit assurer entre 20% et 50% de la destruction des bactéries afin que le traitement par phagothérapie soit efficace, et ce en l’absence ou bien en présence de phénomènes de résistance aux phages. Ainsi, sur le modèle étudié, les chercheurs ont prouvé qu’en aucun cas les phages seuls peuvent éradiquer une infection à P. aeruginosa.
Ces résultats sont d’autant plus importants qu’ils indiquent que les traitements par phagothérapie devraient prendre en compte le statut immunitaire des patients. Comme l’explique Laurent Debarbieux, « en termes de conséquences cliniques, il faudra probablement envisager la sélection des patients susceptibles de bénéficier d’un tel traitement. En effet, la phagothérapie pourrait ne pas être appropriée ou recommandée pour des personnes en situation d’immunodéficience sévère ».
Les chercheurs entendent maintenant décrypter précisément les voies immunitaires impliquées et les mécanismes sous-jacents. En parallèle, des essais cliniques sont en cours, notamment l’essai Phagoburn financé par le 7ème programme cadre de l’Union européenne, sur des infections cutanées chez de grands brûlés.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Effets du lithium sur le cerveau dans le traitement du trouble bipolaire : vers la confirmation dâun mécanisme dâaction |
|
|
| |
|
| |

Effets du lithium sur le cerveau dans le traitement du trouble bipolaire : vers la confirmation d’un mécanisme d’action
COMMUNIQUÉ | 08 AVRIL 2019 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une collaboration entre le CEA, l’INSERM, l’Institut Pasteur, la Fondation FondaMental, les Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor AP-HP et le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, apporte un nouvel éclairage sur l’action du lithium dans le traitement des troubles bipolaires. La modélisation de la diffusion de l’eau (NODDI[1]), mesurée par IRM, a permis d’analyser la microstructure cérébrale de patients souffrant de troubles bipolaires. Les résultats indiquent une densité dendritique augmentée dans le des patients traités par lithium. Ils étayent l’hypothèse selon laquelle une amélioration de la plasticité du cerveau et de la communication entre neurones dans cette région du cerveau aurait des effets bénéfiques du lithium dans le traitement des troubles bipolaires. Ces résultats sont publiés dans le journal « Psychotherapy and Psychosomatics » le 5 avril 2019.
Les résultats de cette étude permettent de confirmer que la prise régulière de lithium est associée à une plasticité bénéfique de la matière grise, mais est surtout la première à permettre d’en préciser l’origine à l’échelle microscopique grâce à la simulation numérique. Ces premiers résultats, qui nécessitent d’être reproduits, suggèrent qu’une amélioration de la communication entre neurones dans cette région pourrait étayer l’hypothèse selon laquelle le lithium aurait des effets bénéfiques dans le traitement des troubles bipolaires. Au-delà, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives très intéressantes pour d’autres pathologies neurologiques ou psychiatriques.
Augmentation de la densité des dendrites.
Les données d’imagerie par résonance magnétique de diffusion (voir encadré) acquises chez 41 participants souffrant de troubles bipolaires et suivis au sein du service de psychiatrie de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP et du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, dont l’expertise clinique est appuyée par celle des centres experts des Troubles Bipolaires de la fondation FondaMental, ont été comparées aux mêmes données recueillies chez 40 volontaires sains issus des deux centres.
Les résultats de l’étude montrent que les patients traités par lithium ont une densité des dendrites plus importante dans la région frontale en comparaison aux patients ne prenant pas de lithium. Les dendrites sont des prolongements des corps cellulaires des neurones recevant l’information transmise par leurs voisins. Le niveau de densité dendritique semble être identique chez les sujets sains et chez les patients traités par lithium alors que le niveau de densité dendritique dans cette région frontale reste inférieur chez les patients non traités par lithium.
Le lithium est un traitement utilisé depuis près d’un siècle chez les patients souffrant de trouble bipolaire et reconnu comme le meilleur stabilisateur de l’humeur. Bien que son efficacité ne soit plus à prouver, les mécanismes biologiques de son action thérapeutique sur le cerveau restent encore mal connus, supposés multiples, et semblent notamment agir sur le tissu en lui-même en entraînant une préservation, voire une augmentation du volume de la matière grise. Jusqu’à présent, il n’était pas possible de qualifier ou quantifier quels changements s’opéraient à l’échelle microscopique.
Repère
Le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique qui touche 1 % de la population mondiale, soit près de 80 millions de personnes dans le monde et 700 000 en France.
Apport de l’IRM de diffusion et de la modélisation
L’émergence de nouvelles techniques d’imagerie par résonance magnétique capables de rendre compte de l’organisation du tissu cérébral à l’échelle microscopique (aussi appelée microstructure) permet aujourd’hui de cartographier directement le cerveau à l’échelle microscopique. Cette nouvelle approche repose sur l’observation par IRM du déplacement des molécules d’eau dans le cerveau (communément appelé processus de diffusion), déplacement largement perturbé par la présence des cellules au sein du tissu cérébral. Ces perturbations du mouvement de l’eau induisent à leur tour une modification du signal IRM qui est propre à l’organisation cellulaire sous-jacente. Grâce à un modèle mathématique nommé NODDI, il est devenu possible d’analyser les données d’IRM de diffusion acquises chez les patients adultes et de déterminer les propriétés microscopiques du tissu. Cette nouvelle méthode, disponible sur la plateforme d’imagerie par résonance magnétique du centre NeuroSpin, a ainsi permis de caractériser les propriétés microscopiques de la substance grise de patients souffrant d’un trouble bipolaire et de les comparer à ceux de sujets sains.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les calpaïnes, enzymes cellulaires clés pour la lutte anti-grippale |
|
|
| |
|
| |

Les calpaïnes, enzymes cellulaires clés pour la lutte anti-grippale
COMMUNIQUÉ | 16 FÉVR. 2016 - 10H07 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Pourquoi ne pas combattre le virus de la grippe en bloquant la machinerie cellulaire qu’il utilise pour se répliquer ? Des chercheurs de l’Inserm (Unité 1100 “Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires”), de l’Institut Pasteur et du pôle de recherche Pasteur-Université de Hong Kong ont testé cette hypothèse en ciblant spécifiquement les calpaïnes, des protéases impliquées dans les mécanismes inflammatoires. Leurs résultats, obtenus chez l’animal, montrent que l’inhibition de ces enzymes peut réduire les symptômes de la maladie mais aussi prévenir l’infection par les virus de la grippe saisonnière ou pandémique.
Les données de cette étude ont été publiées dans l’American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology en janvier 2016.
Les conséquences cliniques de la grippe résultent surtout de l’inflammation dérégulée du tissu pulmonaire, qui peut provoquer des lésions sévères, voire mortelles. Le Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires et les équipes associées ont montré que ce processus inflammatoire pouvait être inhibé en bloquant les calpaïnes, des protéases présentes au sein des cellules hôtes. Le blocage de ces enzymes pourrait jouer un rôle-clé dans la lutte antigrippale : chez la souris, l’inhibition des calpaïnes permet de limiter l’infection par un virus de la grippe saisonnière (H3N2) ou pandémique (H5N1).
«Il existe deux calpaïnes exprimées de manière ubiquitaire dans l’organisme, la calpaïne 1 et la calpaïne 2 », précise le directeur de l’Unité Inserm 1100, Mustapha Si-Tahar. « Elles sont très étudiées car elles joueraient un rôle notable dans différents processus physiopathologiques, comme la neuro-dégénérescence, la dystrophie musculaire ou le diabète. Les différents travaux qui ont permis de décrypter leurs fonctions ont montré que ces protéases jouaient aussi un rôle dans la cascade inflammatoire, selon un mécanisme calcium-dépendant. Or, le virus de la grippe accroît le calcium intracellulaire et la réponse inflammatoire.»
Les travaux conduits par son équipe montrent que les calpaïnes sont activées au cours de l’infection grippale. A l’inverse, leur inhibition réduit la capacité du virus à se répliquer dans les cellules épithéliales respiratoires– qu’elles soient murines ou humaines.
Elle réduit également l’intensité de la réponse inflammatoire néfaste et accroît le taux de survie de l’hôte infecté.
Ces résultats apportent de nouvelles perspectives dans la lutte contre la grippe : le blocage de la machinerie des cellules de l’hôte serait en effet une alternative intéressante car il limiterait la pression sélective des traitements anti-grippaux et donc l’émergence de souches virales résistantes. L’enjeu est de taille : la grippe saisonnière constitue un problème de santé publique avec 2500 à 3500 décès chaque année en France. En outre, certaines épidémies de grippe peuvent conduire à une forte surmortalité comme en 2015 avec plus de 18000 décès enregistrés sur le territoire et les pandémies grippales pourraient avoir des conséquences encore plus graves, à l’image de la grippe espagnole qui tua plus de 50 millions de personnes entre 1918 et 1919.
Les chercheurs souhaitent maintenant approfondir deux aspects : le rôle respectif des deux formes de l’enzyme et la nature précise des mécanismes moléculaires régissant l’interaction calpaïnes – virus grippal. Ces travaux permettront de confirmer le potentiel thérapeutique des calpaïnes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
