|
| |
|
|
 |
|
La metformine améliore la motricité de patients atteints de dystrophie myotonique de Steinert, la maladie neuromusculaire la plus fréquente de lâadult |
|
|
| |
|
| |

La metformine améliore la motricité de patients atteints de dystrophie myotonique de Steinert, la maladie neuromusculaire la plus fréquente de l’adulte
30 AOÛT 2018 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Des chercheurs Inserm au sein d’I-Stem, l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques, annoncent des résultats encourageants de la metformine, un antidiabétique connu, pour le traitement symptomatique de la dystrophie myotonique de Steinert. En effet, un essai de phase II réalisé chez 40 malades, à l’hôpital Henri-Mondor AP-HP, montre que, après 48 semaines de traitement à la plus forte dose, les patients traités avec la metformine (contre placebo) gagnent en motricité et retrouvent une démarche plus stable. Les résultats de cet essai, financé à hauteur d’1,5 million d’euros par l’AFM-Téléthon, sont publiés ce jour dans la revue Brain.
La dystrophie myotonique de Steinert (DM1) est la plus fréquente des dystrophies musculaires de l’adulte. D’origine génétique, sa prévalence est estimée à 1/8.000, soit environ 7 à 8000 malades en France. Elle affecte les muscles, qui s’affaiblissent (dystrophie) et ont du mal à se relâcher après contraction (myotonie) ce qui désorganise les mouvements (marche instable par exemple). Elle atteint également d’autres organes (cœur et appareil respiratoire, appareil digestif, système endocrinien et système nerveux). A ce jour, cette dystrophie musculaire ne bénéficie d’aucun traitement curatif.
Les résultats publiés dans Brain sont le fruit d’une recherche menée depuis plusieurs années au sein d’I-Stem. En effet, grâce au développement de modèles cellulaires à partir de cellules souches pluripotentes, l’équipe de Cécile Martinat a, en 2011, identifié des mécanismes nouveaux à l’origine de la dystrophie myotonique de Steinert (Cell Stem Cell – 31 mars 2011). En 2015, Sandrine Baghdoyan, ingénieure de recherche à I-Stem, parvient à corriger certains défauts d’épissage dans des cellules souches embryonnaires et dans des myoblastes provenant de personnes atteintes de DM1 grâce à la metformine, une molécule anti-diabétique bien connue et identifiée comme efficace dans cette nouvelle indication grâce au criblage à haut-débit.(Mol.Therapy – 3 nov 2015).
Forts de ces résultats, I-Stem a lancé un essai clinique monocentrique de phase II, en double aveugle, randomisé contrôlé, chez 40 patients, en collaboration avec des équipes de l’Hôpital Henri Mondor AP-HP, celle du Dr Guillaume Bassez du centre de référence maladies neuromusculaires Ile-de-France, et celle du Centre d’Investigation Clinique coordonné par le Pr Philippe Le Corvoisier. Dans cette étude contre placebo, la metformine a été administrée trois fois par jour, par voie orale, avec une période d’augmentation de la dose sur 4 semaines (jusqu’à 3 g/jour), suivie de 48 semaines à la dose maximale.
L’évaluation de l’efficacité du traitement était notamment fondée sur le test de « 6 minutes de marche ». A la fin de l’étude, soit après un an de traitement, les patients ayant reçu la metformine gagnent une distance moyenne de marche de près de 33 mètres sur les performances initiales alors que le groupe ayant reçu le placebo reste stable (gain moyen de 3 mètres).
Cette motricité, analysée finement grâce à l’outil Locometryx développé par le laboratoire de physiologie et d’évaluation neuromusculaire de Jean-Yves Hogrel à l’Institut de Myologie au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, est étroitement liée au fait que la metformine améliore la posture globale des patients qui, de fait, passent d’une marche instable « élargie », avant traitement, à une démarche droite, plus rapide et donc plus performante ».
Ces résultats démontrent, pour la première fois, l’efficacité d’un traitement pharmacologique sur la motricité dans la dystrophie myotonique de Steinert et, à notre connaissance, l’efficacité thérapeutique d’une molécule identifiée sur la base de la modélisation d’une pathologie avec des cellules souches pluripotentes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Horloge biologique : Ã chaque organe, son rythme |
|
|
| |
|
| |
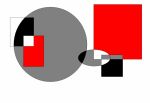
Horloge biologique : à chaque organe, son rythme
08 FÉV 2018 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une équipe de chercheurs de l’Inserm dirigée par Howard Cooper (Unité Inserm 1208 » Institut cellule souche et cerveau ») en collaboration avec des collègues américains fournit pour la première fois une cartographie inédite de l’expression des gènes, organe par organe, et selon le moment de la journée ; un travail colossal commencé il y a dix ans et qui a nécessité deux ans d’analyse. Ces résultats publiés dans Science montrent combien il est important de tenir compte de l’horloge biologique pour administrer les médicaments au bon moment afin d’améliorer leur efficacité et d’en réduire les effets indésirables. Les chercheurs préparent désormais un atlas qui sera disponible pour l’ensemble de la communauté.
Environ deux tiers des gènes codant pour des protéines sont exprimés de façon cyclique au cours des 24 heures avec des pics en matinée et en début de soirée. Néanmoins, cette expression varie beaucoup d’un tissu à l’autre confirmant que, en plus de l’horloge centrale interne, chaque organe exprime sa propre horloge. Une équipe Inserm le prouve pour la première fois chez une espèce diurne et fournit une cartographie spatio-temporelle inédite de l’expression circadienne des gènes pour l’ensemble des organes. Ces travaux marquent une avancée majeure dans le domaine de la chronobiologie.
Jusque-là, les études destinées à explorer le rythme circadien dans les différents organes étaient menées principalement chez des animaux modèles comme la drosophile (travaux récompensés l’année dernière par le prix Nobel) et les espèces nocturnes, en particulier la souris. L’horloge circadienne étant principalement synchronisée par le cycle de lumière jour-nuit, il aurait été tentant d’inverser le cycle pour obtenir des données chez les animaux diurnes. Mais les rongeurs ne sont pas seulement en décalage de phase par rapport à l’homme, ils ont aussi un mode de vie très différent : un sommeil fragmenté de jour comme de nuit contre un sommeil plus consolidé pendant la nuit pour les diurnes ou encore une alimentation permanente pendant la phase d’éveil nocturne alors que les hommes prennent des repas répartis de façon régulière. Autant de facteurs qui contribuent également à la synchronisation de l’horloge biologique. Il était donc temps de travailler chez des espèces plus proches de l’homme pour en savoir plus chez ce dernier.
Pour cela, les chercheurs ont analysés les ARNs de plus de 25 000 gènes de 64 organes et tissus, toutes les deux heures et pendant vingt-quatre heures, chez des primates non humains. Les organes principaux ont été passés au crible ainsi que différentes régions du cerveau. Au total, les chercheurs ont analysé 768 prélèvements. Un travail colossal commencé il y a dix ans et qui a nécessité deux ans d’analyse ! Pour chacun d’entre eux, ils ont recherché, quantifié et identifié les ARN présents dans les cellules. Ces ARN deviennent ensuite des protéines ou restent à l’état d’ARN avec des propriétés régulatrices sur d’autres molécules. C’est ce qu’on appelle le transcriptome.
80% des gènes réglés sur l’horloge biologique assurent les fonctions essentielles des cellules
Les auteurs ont constaté que 80% des gènes exprimés de façon cyclique, codent pour des protéines assurant des fonctions essentielles de la vie des cellules comme l’élimination des déchets, la réplication et la réparation de l’ADN, le métabolisme, etc. Mais, il existe une très grande diversité des transcriptomes, c’est-à-dire de l’ensemble des ARN, présents dans les cellules des différents échantillons au cours des 24 heures.
Le nombre de gènes exprimés de façon cyclique varie en nombre (environ 3000 dans la thyroïde ou le cortex préfrontal contre seulement 200 dans la moelle osseuse) et en nature : moins de 1% des gènes « rythmiques » dans un tissu le sont également dans les autres tissus.
Même les treize gènes connus de l’horloge biologique, que les auteurs s’attendaient à retrouver de façon cyclique dans tous les échantillons, n’y sont finalement pas tous présents, pas dans les mêmes quantités ou pas au même moment. Les seuls points communs entre ces 64 tissus sont finalement les pics bien définis d’expression des gènes au cours de la journée : en fin de matinée et en début de soirée. Le premier, le plus important, survient entre 6 et 8 heures après le réveil avec plus de 11.000 gènes exprimés à ce moment-là dans l’organisme. Et le second moins intense voit environ 5000 gènes en action dans les tissus. Puis, les cellules sont quasiment au repos au cours de la nuit, particulièrement lors de la première partie de la nuit.
Ces résultats ont surpris les auteurs par l’ampleur de la rythmicité des organes du primate non humain et des applications possibles. » Deux tiers des gènes codants fortement rythmés, c’est beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions » clarifie Howard Cooper, directeur de recherche Inserm au sein de l’équipe « Chronobiologie et Désordres Affectifs » de l’Unité Inserm 1208. « Mais surtout, 82% d’entre eux codent des protéines ciblées par des médicaments ou sont des cibles thérapeutiques pour de futurs traitements. Cela prouve combien il est important de tenir compte de l’horloge biologique pour administrer les médicaments au bon moment de la journée afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les effets indésirables. Quelques experts travaillent sur ces questions, notamment dans le domaine du cancer, mais il faut à mon avis aller beaucoup plus loin. C’est pourquoi nous préparons un véritable atlas, sous forme de base de données consultable, pour permettre aux scientifiques du monde entier de connaitre enfin le profil d’expression de chaque gène dans les différents organes au cours de 24 heures « , précise le chercheur
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Pesticides : Effets sur la santé, une expertise collective de lâInserm |
|
|
| |
|
| |

Pesticides : Effets sur la santé, une expertise collective de l’Inserm
13 JUIN 2013 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | SANTÉ PUBLIQUE
Depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques ont évoqué l’implication des pesticides dans plusieurs pathologies chez des personnes exposées professionnellement à ces substances, en particulier des pathologies cancéreuses, des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. Ces enquêtes ont également attiré l’attention sur les effets éventuels d’une exposition même à faible intensité lors de périodes sensibles du développement (in utero et pendant l’enfance).
Dans ce contexte, la DGS a sollicité l’Inserm pour effectuer un bilan de la littérature scientifique permettant de fournir des arguments sur les risques sanitaires associés à l’exposition professionnelle aux pesticides, en particulier en secteur agricole et sur les effets d’une exposition précoce chez le fœtus et les jeunes enfants.
Pour répondre à cette demande, l’Inserm s’est appuyé sur un groupe pluridisciplinaire d’experts constitué d’épidémiologistes spécialistes en santé-environnement ou en santé au travail et de biologistes spécialistes de la toxicologie cellulaire et moléculaire.
D’après les données de la littérature scientifique internationale publiées au cours des 30 dernières années et analysées par ces experts,
il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l’adulte: la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non Hodgkinien, myélomes multiples).
Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période prénatale et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le développement de l’enfant.
© Fotolia
Pesticides : définitions, usages et voies d’exposition
Du latin, Pestis (fléau) et Caedere (tuer), le terme pesticide regroupe de nombreuses substances très variées agissant sur des organismes vivants (insectes, vertébrés, vers, plantes, champignons, bactéries) pour les détruire, les contrôler ou les repousser.
Il existe une très grande hétérogénéité de pesticides (environ 1 000 substances actives ont déjà été mises sur le marché, entre hier et aujourd’hui, actuellement 309 substances phytopharmaceutiques sont autorisées en France). Ils divergent selon leurs cibles, leurs modes d’actions, leurs classe chimiques ou encore leur persistance dans l’environnement.
– Cibles : on distingue les herbicides, les fongicides, les insecticides…
– Il existe près de 100 familles chimiques de pesticides : organophosphorés, organochlorés, carbamates, pyréthrinoïdes, triazines…
– Il existe près de 10 000 formulations commerciales composées de la matière active et d’adjuvants et qui se présentent sous différentes formes (liquides, solides : granulés, poudres,…..).
– La rémanence des pesticides dans l’environnement peut varier de quelques heures ou jours à plusieurs années. Ils sont transformés ou dégradés en nombreux métabolites. Certains, comme les organochlorés persistent pendant des années dans l’environnement et se retrouvent dans la chaine alimentaire.
Dans l’expertise, le terme pesticide représente l’ensemble des substances actives, indépendamment des définitions réglementaires.
Des pesticides pour quels usages ?
En France, peu de données quantitatives par type d’usages sont accessibles. La majeure partie des tonnages (90%) est utilisée pour les besoins de l’agriculture, mais d’autres secteurs professionnels sont concernés : entretiens des voiries, jardins et parcs ; secteur industriel (fabrication, traitement du bois,…) ; usage en santé humaine et vétérinaire, lutte anti-vectorielle (moustique), dératisations…Il faut ajouter à cette liste les usages domestiques (plantes, animaux, désinsectisation, jardinage, bois).
En France, les fongicides représentent près de la moitié des tonnages. 80% des tonnages de pesticides sont utilisés pour un traitement des céréales à paille, maïs, colza, vigne. Les plus vendus ont comme principe actif le soufre ou le glyphosate.
Les sources d’exposition :
Les pesticides sont présents partout dans l’environnement. On peut les trouver dans l’air (air extérieur et intérieur, poussières), l’eau (souterraines, de surface, littoral, …), le sol, et les denrées alimentaires (y compris certaines eaux de consommation).
En milieu professionnel, la voie cutanée représente la principale voie d’exposition (environ 80%). L’exposition par voie respiratoire existe lors de circonstances particulières d’application (fumigation, utilisation en milieu fermé). L’exposition peut se produire à différents moments : manutention, préparation, application, nettoyage, ré-entrées (tâches effectuées dans des zones traitées), mais les plus exposantes sont la préparation des bouillies ou mélanges et les tâches de ré-entrées. En population générale, la voie orale est souvent considérée comme la principale voie d’exposition à travers l’alimentation.
Pesticides et cancers
L’expertise collective a ciblé 8 localisations de cancer : 4 cancers hématopoïétiques, ainsi que les cancers de la prostate, du testicule, les tumeurs cérébrales et les mélanomes. La plupart de ces localisations avaient été identifiées dans des méta-analyses antérieures comme potentiellement associées à une exposition aux pesticides, généralement sans distinction sur les matières actives incriminées.
Cancer de la prostate
D’après les données de la littérature, une augmentation du risque existe chez les agriculteurs, les ouvriers d’usines de production de pesticides et les populations rurales (entre 12 et 28% selon les populations). Quelques matières actives ont été spécifiquement documentées, en population générale : chlordécone ; en population professionnelle : carbofuran, coumaphos, fonofos, perméthrine. Toutes sont actuellement interdites d’usage. Pour certaines d’entre elles, un excès de risque est observé uniquement chez les agriculteurs ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate.
Cancers hématopoïétiques
D’après les données de la littérature, une augmentation de risque de lymphomes non hodgkinien et de myélomes multiples existe chez les professionnels exposés aux pesticides du secteur agricole et non agricole. Les pesticides organophosphorés et certains organochlorés (lindane, DDT) sont suspectés. Bien que les résultats soient moins convergents, un excès de risque de leucémies ne peut être écarté.
Concernant les autres localisations cancéreuses étudiées, l’analyse de l’ensemble des études reste difficile. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : une incidence faible (cancer du testicule, tumeurs du cerveau et maladie de Hodgkin) ou l’existence d’un facteur de confusion important (comme par exemple, l’exposition aux ultras violets de la population agricole, facteur de risque reconnu pour le mélanome).
Pesticides et maladies neurodégénératives
L’expertise collective s’est intéressée a 3 maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu’aux troubles cognitifs, qui pourraient prédire ou accompagner certaines pathologies neuro-dégénératives.
Maladie de Parkinson
Une augmentation du risque de développer une maladie de Parkinson a été observée chez les personnes exposées professionnellement aux pesticides. Un lien a pu être mis en évidence notamment lors d’une exposition aux insecticides et herbicides. L’association avec les fongicides n’a, à ce jour, pas été mise en évidence mais le nombre d’études est nettement moins important.
Pour les autres maladies neurodégénératives, les résultats sont plus contrastés. Par exemple, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, les résultats des études de cohortes sont convergents pour révéler un excès de risque quand les études cas-témoins sont peu robustes. Quant à la sclérose latérale amyotrophique, trop peu d’études sont disponibles pour conclure.
Par ailleurs, plusieurs revues et une méta-analyse récente concluent à un effet délétère des expositions professionnelles aux pesticides notamment aux organophosphorés sur le fonctionnement cognitif. Cet effet serait plus clair en cas d’antécédents d’intoxication aigue.
Effets sur la grossesse et le développement de l’enfant
Il existe maintenant de nombreuses études épidémiologiques suggérant un lien entre l’exposition prénatale aux pesticides et le développement de l’enfant, à court et moyen terme.
Conséquences des expositions professionnelles en période prénatale
La littérature suggère une augmentation significative du risque de morts fœtales (fausses-couches) ainsi qu’une augmentation du risque de malformations congénitales lors d’une exposition professionnelle maternelle aux pesticides. D’autres études pointent une atteinte de la motricité fine et de l’acuité visuelle ou encore de la mémoire récente lors du développement de l’enfant. Enfin, une augmentation significative du risque de leucémie et de tumeurs cérébrales a été mise en évidence dans les méta- analyses récentes.
Conséquences des expositions résidentielles en période prénatale (voisinage ou usage domestique)
Plusieurs études cas-témoins et de cohortes montrent une augmentation du risque de malformations congénitales chez les enfants des femmes vivant au voisinage d’une zone agricole ou liée aux usages domestiques de pesticides (malformations cardiaques, du tube neural, hypospadias).
Une diminution du poids de naissance, des atteintes neurodéveloppementales et une augmentation significative du risque de leucémie sont également rapportées.
Pesticides et fertilité
Le lien entre certains pesticides (notamment le dibromochloropropane), qui ne sont plus utilisés, et des atteintes de la fertilité masculine a été clairement établi mais de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne les pesticides actuellement employés.
Le lien entre pesticides et infertilité chez la femme est mal connu et mériterait d’être mieux étudié.
Mécanismes biologiques
La littérature ne permet pas actuellement d’identifier avec précision les mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu dans les pathologies potentiellement associées à une exposition à certains pesticides. Toutefois, certains modes d’action des substances soutiennent les données épidémiologiques. Le stress oxydant semble par exemple jouer un rôle majeur, comme dans la maladie de Parkinson. Des dommages à l’ADN ou des perturbations de certaines voies de signalisation pouvant conduire à une dérégulation de la prolifération ou de la mort cellulaire, ou des altérations du système immunitaire sont autant de mécanismes susceptibles de sous tendre les effets des pesticides sur la santé.
La question des mélanges de pesticides
Les populations sont exposées de façon permanente et à faible dose aux pesticides et à de nombreuses autres substances contaminant l’environnement. Ces mélanges de pesticides et autres substances pourraient donner lieu à des impacts sanitaires difficilement prévisibles actuellement, ce qui fait de la question des mélanges et des faibles doses un des enjeux importants de la recherche et de l’évaluation des dangers.
Les experts rappellent que «ne pas être en mesure de conclure ne veut pas dire obligatoirement qu’il n’y a pas de risque».
Si certaines substances sont mises en cause, c’est qu’elles ont été plus souvent étudiées que d’autres (en particulier dans le contexte des États-Unis) ; de nombreuses substances actives n’ont pas fait l’objet d’études épidémiologiques.
Recommandations
Les recommandations soulignent la nécessité d’une meilleure connaissance des données d’exposition anciennes et actuelles de la population professionnelle exposée aux pesticides directement ou indirectement.
Les recommandations attirent également l’attention sur des périodes critiques d’exposition (périodes de développement) aussi bien en milieu professionnel qu’en population générale.
Des recherches pluri- et trans-disciplinaire doivent être soutenues pour permettre une caractérisation plus rapide des dangers potentiels des substances actives de pesticides.
Lire l’intégralité du dossier de presse
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
A Toulouse, une découverte majeure dans la prise en charge de lâinsuffisance rénale chronique |
|
|
| |
|
| |
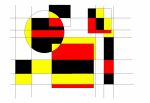
A Toulouse, une découverte majeure dans la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
19 SEP 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Des chercheurs et chercheuses du CHU de Toulouse, de l’Inserm et de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier ont récemment fait une découverte dans la compréhension et le traitement de l’insuffisance rénale chronique, une pathologie touchant des millions de personnes à travers le monde. Publiée dans Science Translational Medicine, cette avancée scientifique prometteuse repose sur l’identification de la responsabilité d’une protéine inflammatoire dans les complications graves de la maladie, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle approche thérapeutique.
La calcification vasculaire : une complication grave de l’insuffisance rénale
L’insuffisance rénale chronique touche 10% de la population adulte mondiale et jusqu’à 30% des personnes de plus de 70 ans en Europe.
L’une des principales complications de l’insuffisance rénale chronique est la calcification vasculaire, un phénomène au cours duquel des minéraux s’accumulent anormalement dans les parois des vaisseaux sanguins, provoquant leur rigidification et contribuant au développement de maladies cardiovasculaires graves, qui sont les principales causes de décès chez ces patients.
A date, les traitements à disposition ont des effets limités et ne permettent pas de prévenir ou de traiter la calcification vasculaire.
Une nouvelle approche thérapeutique liée à l’identification des ressorts de la calcification vasculaire
L’équipe de recherche a mené une analyse protéomique (méthode d’exploration des protéines présentes dans un échantillon biologique) à grande échelle, combinée à des analyses ciblées en ELISA sur des échantillons de plasma de patients atteints d’insuffisance rénale et de patients dialysés (cohorte de 453 patients issus de la cohorte CKDomique du CHU de Toulouse, de la cohorte espagnole Nefrona, de la cohorte suédoise KärlTx du Karolinska Institutet, et de l’association réunionnaise AURAR.
Le test ELISA est un test immunologique qui permet la détection ou le dosage de molécules dans un échantillon biologique.
Cette analyse a permis d’identifier la présence d’une protéine inflammatoire appelée calprotectine, dont le taux élevé dans le sang des patients était fortement associé au développement de complications cardiovasculaires et à la mortalité chez ces patients.
Plus important encore, des études in vivo et in vitro ont permis de démontrer le rôle direct de la calprotectine dans la calcification vasculaire, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle approche thérapeutique. En effet, cette étude permet de souligner le potentiel thérapeutique du paquinimod, un inhibiteur de la calprotectine, qui se révèle prometteur en tant que candidat médicament pour limiter le développement de la calcification vasculaire.
« Cette étude translationnelle européenne offre des perspectives prometteuses pour améliorer la prise en charge des patients en insuffisance rénale et en dialyse en ciblant la calcification vasculaire. Elle représente une avancée majeure dans la compréhension de la physiopathologie de la calcification vasculaire liée à l’insuffisance rénale. Sur le plan médical, ces résultats ouvrent la voie à l’utilisation potentielle du paquinimod comme traitement, ce qui pourrait réduire la morbidité et la mortalité dues à des événements cardiovasculaires évitables chez les patients en insuffisance rénale. » Julie Klein, Renal Fibrosis Lab / Institut I2MC (UMR1297 Inserm / Université Toulouse III – Paul Sabatier) & Pr Stanislas Faguer, Département de Néphrologie et Transplantation d’Organes du CHU de Toulouse (dirigé par le Pr Nassim Kamar) / Institut I2MC (UMR1297 Inserm / Université Toulouse III – Paul Sabatier)
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
